Prérequis à l'entrée à l'université: le début de la sélection?
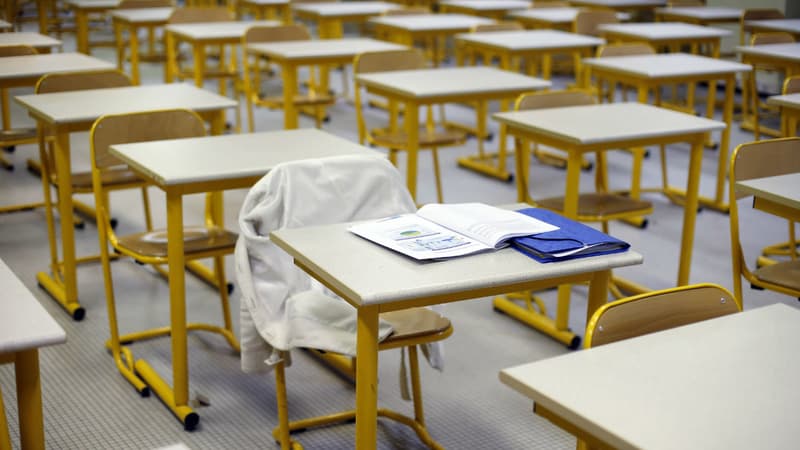
Une salle d'examen dans un lycéen parisien (photo d'illustration) - Thomas Samson-AFP
Bientôt la fin du tabou de la sélection? La réforme des admissions à l'université est discutée ce lundi par les acteurs de l'éducation au ministère de l'Enseignement supérieur alors que l'affectation des lycéens pour leur première année d'études supérieures est à nouveau sujette à controverse - des filières ont recouru au tirage au sort. Et quelque 86.969 bacheliers sont toujours sur liste d'attente après la troisième vague de réponses de la plateforme APB.
Les prérequis, une sélection déguisée?
Au menu des discussions: la mise en place de prérequis dès la rentrée 2018 pour conditionner l'entrée à l'université. C'était une des promesses du candidat Emmanuel Macron durant sa campagne. Le nouveau président de la République souhaitait que les futurs étudiants aient des "prérequis" afin d'entrer à l'université pour "enrayer l'échec" scolaire. Ce qu'a confirmé Édouard Philippe lors de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Ces "contrats de réussite étudiante" mettront un terme à la sélection par tirage au sort, qualifiée de "scandale absolu" par le Premier ministre, et promouvront "le mérite et la motivation".
Mais derrière les mots "prérequis" ou "contrat de réussite", de nombreuses organisations syndicales, comme la Sgen-CFDT ou l'Unef, ont dénoncé une sélection déguisée.
Un procédé "plus juste"
La sélection à l'entrée de l'université a longtemps été taboue. Comme le rappelle Claude Lelièvre, historien de l'éducation joint par BFMTV.com, plusieurs tentatives en ce sens ont échoué par le passé.
"Sous la présidence de de Gaulle, alors que le nombre de bacheliers avait doublé, le ministre de l'Éducation nationale, Alain Peyrefitte, avait envisagé une forme de sélection. L'entrée à l'université était garantie aux bacheliers ayant obtenu une mention ou de très bons résultats dans les matières concernées. Mai-68 a balayé cette réforme. Près de vingt ans plus tard, en 1986, le projet de loi Devaquet, sous Mitterrand, prévoyait à nouveau de sélectionner les étudiants ainsi que de donner plus de liberté quant aux frais d'inscription. Une mobilisation étudiante l'a enterré."
Si le mot "sélection" met certains vent debout, d'autres l'assument, comme Paul Cassia, professeur de droit public à l'université Paris-I-Panthéon-Sorbonne. "La sélection sur prérequis est un procédé plus juste que celui reposant sur l'aléa", déclarait-il dans une tribune à Libération. Il assurait également que la sélection était "déjà pratiquée - quoique de manière illégale - pour certains parcours universitaires". Sans compter qu'à la rentrée, les établissements supérieurs pourront établir des critères d'entrée en master.
Un système "hypocrite" et "à bout de souffle"
Une hypocrisie que dénonce pour BFMTV.com François Dubet, sociologue de l'éducation.
"Notre système éducatif doit sortir de cette légende selon laquelle il ne serait pas sélectif. Classes préparatoires, IUT, médecine, double licence ou encore grandes écoles: il y a de la sélection. C'est d'autant plus absurde que certains lycéens sont tirés au sort. Le système est épuisé et à bout de souffle."
Si le mot sélection fait peur et "peut mettre des centaines de milliers de lycéens dans la rue", ajoute François Dubet, également ancien directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, l'université ne pourra pourtant pas y échapper. "On ne peut pas continuer à tourner autour du pot", insiste-t-il.
Le défaut d'orientation au lycée
Mais la mise en place de cette sélection sera complexe, estime Claude Lelièvre.
"Des prérequis validés par un jury d'enseignants ou un examen, qui seraient différents et avec des critères d'évaluation variables selon chaque université, n'auraient aucun sens. Cette question doit être traitée bien en amont avec une réforme du lycée."
Selon lui, la question de l'orientation arrive encore trop tard dans la scolarité des lycéens. C'est d'ailleurs ce que pointent certains participants à la concertation, comme la Fage, le premier syndicat étudiant, qui dénonce le défaut d'orientation pendant la scolarité lycéenne. Déficience qui se traduit par un taux élevé d'échec en licence: seuls 40% des étudiants bouclent leur licence.
"Le bac n'informe pas sur les compétences"
Le problème résiderait même plus particulièrement dans l'évaluation en fin de terminale, estime pour BFMTV Thierry Chevaillier, chercheur à l'Institut de recherche sur l'éducation de l'Université de Bourgogne. "On met sur le même pied tous les baccalauréats. Or, on sait très bien que la réussite à l'université est variable selon le bac obtenu. Un bac pro ne prépare pas à l'étude de l'histoire ancienne ou du grec à l'université."
Il estime que la mise en place de prérequis doit s'accompagner d'une réforme du bac - au programme d'Emmanuel Macron - sur le modèle du Royaume-Uni. Les Britanniques sont recrutés à l'université selon les résultats qu'ils ont obtenus à plusieurs matières choisies dès le lycée.
"Le baccalauréat donne une moyenne générale mais n'informe pas sur les compétences des étudiants, pointe Thierry Chevaillier. Un lycéen peut avoir un bac S sans pour autant avoir eu de bonnes notes dans les matières scientifiques par le jeu des autres matières et des options."
Les prérequis, une partie de la solution
Si la mise en place de ces prérequis apparaît comme une solution à un système d'affectation qui semble injuste et au fort taux d'échec scolaire, il ne réglera qu'une partie du problème, remarque François Dubet.
"Quel droit aux études supérieures pourra-t-on garantir aux lycéens qui n'auront pas franchi les prérequis? On ne pourra pas leur dire: 'votre scolarité s'arrête ici'? Et quid des places manquantes à l'université? Cela ne réglera pas non plus la question de la surabondance d'étudiants dans certaines filières, qui sont ainsi dévaluées, et en inadéquation avec le marché du travail."









