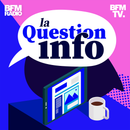Fausses alertes à la bombe: que risquent les auteurs?

Plusieurs aéroports deux jours de suite, le château de Versailles à trois reprises, le Louvre, mais surtout 168 établissements scolaires depuis la rentrée... Ces dernières semaines, les alertes à la bombe se sont multipliées. Si dans l'immense majorité des cas, elles sont infondées, elles nécessitent à chaque fois un processus d'évacuation et l'intervention des forces de l'ordre, dont les équipes de déminage.
Contexte terroriste ou non, "toutes les alertes, sans exception, sont prises au sérieux", expliquait Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police CFDT, à BFMTV.com, mardi 17 octobre. Une fois le doute levé, place à l'identification des auteurs de ces fausses menaces. "Une enquête judiciaire est alors ouverte pour trouver la personne à l'origine de la fausse alerte à la bombe", détaillait Denis Jacob dans notre article précédent.
Des peines sévères
Dans un premier temps, les enquêteurs doivent déterminer le canal par lequel ont circulé ces menaces: un appel passé directement à la police ou à l'établissement visé, un SMS, une lettre, un message émis sur le site Moncommissariat.fr ou un texte sur les réseaux sociaux. En fonction du canal, les enquêteurs tentent ensuite de remonter jusqu'à son auteur, notamment via un numéro de téléphone, un email ou une l'adresse IP. Une fois que l'auteur présumé d'une fausse alerte est interpellé, la machine judiciaire se met en route.
Et pour cause, les auteurs risquent gros. "Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise" est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende, selon l'article 322-14 du Code pénal.
Par ailleurs, la peine encourue est la même si elle est "de nature à provoquer l'intervention inutile des secours". Dans le cas où la fausse alerte à la bombe ou la menace d'un attentat est émise avec "l'ordre de remplir une condition", l'auteur risque jusqu'à trois ans et 45.000 euros d’amende
Des auteurs "retrouvés et punis"
Mais d'autres qualifications juridiques existent. En mai 2019, un étudiant de 23 ans avait été jugé devant le tribunal correctionnel de Rennes pour avoir passé, le 18 janvier de la même année, un appel anonyme faisant qu'une bombe se trouvait à bord d'un vol Easyjet Lyon-Rennes. Il a écopé de 9 mois de prison avec sursis et d'une mise à l'épreuve.
Mais la peine aurait pu être bien plus sévère. En cas de "communication de fausses nouvelles compromettant la sécurité d’un aéronef en vol" ou de "communication de fausses nouvelles compromettant la sécurité d'un navire", les auteurs encourent jusqu'à cinq ans de prison et 75.000 euros d’amende.
Le fait de menacer verbalement d'un attentat contre un train, en échange d'une rançon ou d'une condition, est passible de 6 mois et 3.750 euros d'amende. Si la menace est écrite, la peine est bien plus sévère. Elle peut monter à 2 ans et 3.750 euros d’amende et jusqu'à 5 ans de réclusion et 75.000 euros d’amende, "en échange d'une rançon ou d'une condition".
Enfin, le fait de "dénoncer mensongèrement à l'autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches" est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende. C'est ce qui s'est passé en avril dernier, près de Toulouse. Une femme de 24 ans avait déclenché une fausse alerte à la bombe mettant en cause son compagnon qui descendait voir jouer l'OM au Vélodrome.
Les auteurs "de ces fausses menaces seront retrouvés et punis", a d'ailleurs déclaré le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, ce mercredi.