Comment les juges examinent les demandes de libération conditionnelle des "grands" criminels

Vingt-six ans après sa condamnation pour meurtre, Jean-Claude Romand s'apprête à quitter la prison de Saint-Maur, dans l'Indre. Ce jeudi, les juges ont accédé à sa demande de remise en liberté conditionnelle. Le médecin imposteur condamné à la perpétuité pour l'assassinat de sa famille en 1993 devrait quitter sa cellule avant l'été.
La chambre de l'application des peines de Bourges a par cet arrêt infirmé la décision du tribunal de Châteauroux qui avait refusé, le 8 février dernier, la liberté conditionnelle à ce détenu libérable depuis 2015.
Aider à la réinsertion des détenus
La libération de Jean-Claude Romand est conditionnée à une "période de placement sous surveillance électronique probatoire d'une durée de deux ans", a précisé Marie-Christine Tarrare, procureure générale de Bourges, dans un communiqué. A l'issue de ces deux ans, "le condamné sera soumis pour une durée de dix ans à des mesures d'assistance et de contrôle", selon la même source. Le faux docteur, aujourd'hui âgé de 65 ans, devra alors s'établir "en un lieu autorisé par l'autorité judiciaire", s'abstenir d'entrer en contact avec les victimes et les parties civiles et aura interdiction de se rendre dans les régions Ile-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, précise le communiqué.
La libération conditionnelle est une mesure d'aménagement de peine visant à la réinsertion du détenu. Elle permet de remettre en liberté un condamné avant la date d'expiration normale de sa peine de prison, sous réserve qu'il respecte, pendant un délai d'épreuve, un certain nombre d'obligations. Pour accorder la liberté conditionnelle, le tribunal de l’application des peines (TAP), composé de trois juges, doit apprécier l’opportunité de cette demander "à la lumière de plusieurs expertises", explique à BFMTV.com la magistrate Laurence Blisson.
Evaluer la dangerosité du détenu
Le détenu doit notamment se soumettre à des expertises psychiatriques afin que soit évaluée sa dangerosité. Un élément fondamental dans l’affaire Romand, puisque pendant plus de 15 ans, le faux docteur, aujourd'hui âgé de 64 ans, ment à son entourage. Se faisant passer pour un médecin de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), il dissimule une réalité plus sombre. En effet, Romand passe ses journées dans sa voiture et fait vivre sa famille en escroquant parents et amis. Acculé par plusieurs débiteurs dont certains découvrent son imposture, le faux médecin tombe le masque à l’âge de 38 ans.
Le 9 janvier 1993 au matin, il tue avec un rouleau à pâtisserie sa femme de 37 ans qui dormait dans leur maison à Prévessin-Moëns (Ain). Puis, selon son propre récit, il demande à sa fille Caroline, sept ans, de s'allonger pour qu'il prenne sa température et lui tire dans le dos avec une carabine. Il réserve le même sort à son fils de cinq ans, Antoine.
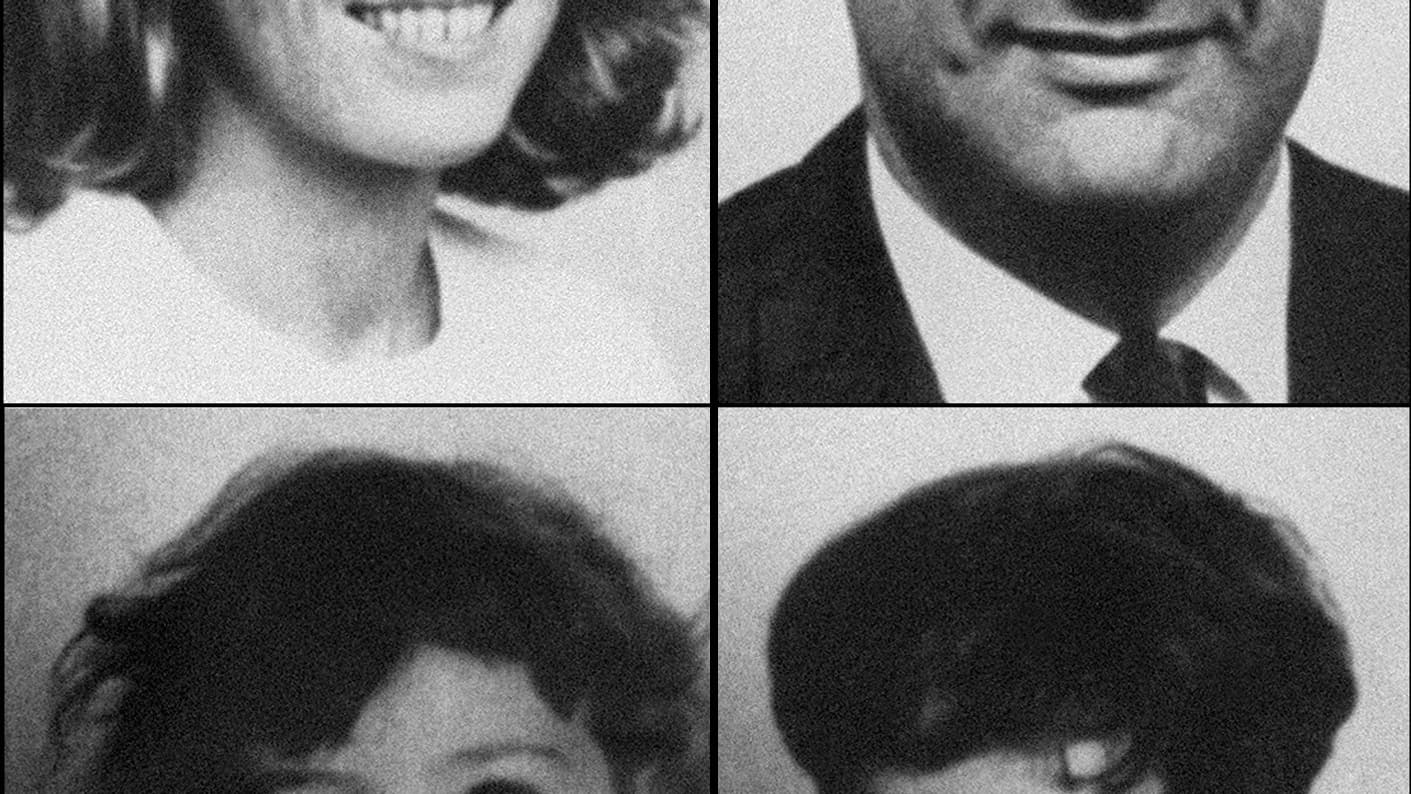
Il se rend ensuite chez ses parents à Clairvaux-les-Lacs (Jura), à environ 80 kilomètres de chez lui, et les tue de plusieurs balles dans le dos. Jean-Claude Romand retourne finalement à son domicile et tente de se suicider. Les pompiers le retrouvent inconscient mais vivant.
"Un banal accident et une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon", avait-il écrit dans un message retrouvé par les enquêteurs.
Avoir un projet de réinsertion
Dans un tel contexte de violence et dans le cas où la peine dépasse les 15 années d’emprisonnement, le détenu doit en plus être évalué pendant six semaines par le Centre national d’évaluation des personnes détenues, précise Laurence Blisson. "Le centre émet un avis sur l’état du détenu qui nous aide à statuer".
Par ailleurs, le TAP doit vérifier la validité du projet de réinsertion - personnelle et professionnelle - de celui qui prétend à une libération conditionnelle.
"Les peines de réclusion sont longues, a fortiori les détenus sont désocialisés et n’ont souvent plus de lien avec leur famille. Nous devons nous assurer que leur projet est viable et qu’ils auront des contacts à leur sortie", souligne la juge d'application des peines.
A l’issue d'une audience le 20 novembre, l’avocat de Jean-Claude Romand, Jean-Louis Abad, avait en tout cas estimé avoir "tout examiné dans le détail. Son projet est très bien ficelé et très sérieux." Sans toutefois préciser davantage les plans professionnels et personnels présentés par son client aux juges qui décideront de son avenir.
Veillez à la protection des victimes
La protection des victimes est un autre élément fondamental que les juges doivent prendre en considération. "Quand un criminel est remis en liberté conditionnelle, cette mesure s’accompagne généralement d’une interdiction d’entrer en contact avec les victimes ou leur famille. Il peut également lui être interdit de résider ou d’exercer une fonction dans le même département", détaille Laurence Blisson.
Et d’ajouter: "Accorder une remise en liberté conditionnelle est parfois difficile. Dans le cas d’anciens ‘grands’ criminels, on peut ne pas être totalement rassuré, la personne peut ne pas être réellement prête. Même si on bénéficie de l’avis de nombreux experts, ces situations sont complexes à évaluer, sachant que, plus la durée de la peine est élevée, plus la personne est désocialisée. C’est d’autant plus difficile quand l’affaire a été très médiatisée, comme dans le cas de Guy Georges, par exemple, qui a été présenté comme irrécupérable."
Condamné en 2001 à 22 ans de sûreté pour les meurtres de sept femmes, celui qui est surnommé "le tueur de l'Est parisien" pourrait être libéré à partir de 2023. Patrice Alègre, le tueur toulousain, condamné en février 2002 à la réclusion criminelle à perpétuité et à 22 ans de sûreté pour cinq meurtres, est quant à lui libérable dès 2019.
Mesure encadrée pour éviter la récidive
La magistrate l’assure, le risque de récidive est moins élevé dans un contexte de remise en liberté conditionnelle qu’en fin de peine, "grâce notamment au suivi de la personne par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP). Le détenu n'est pas relâché seul dans la nature". Le cas de Patrick Gateau avait pourtant relancé le débat sur le durcissement de la répression.
En 2008, la Cour d’assises de Seine-et-Marne l’a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, pour la deuxième fois, pour l'assassinat de Nelly Crémel, commis alors qu’il bénéficiait d’une remise en liberté conditionnelle depuis 2003. En 1990, Patrick Gateau avait déjà écopé de la perpétuité pour avoir assassiné, avec un ami, la maîtresse occasionnelle de celui-ci, pour lui prendre sa voiture. Lors de sa libération conditionnelle, Gateau avait retrouvé sa femme, un logement et du travail.
"Il faut avoir confiance dans la repentance des détenus, soutient malgré tout Laurence Blisson. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle d’ailleurs qu’il n’est pas possible d’interdire une éventuelle chance de retrouver la liberté", souligne-t-elle. Dans une décision de 2012, la Cour avait reconnu "le but légitime d’une politique de réinsertion sociale progressive, même lorsque la personne a été condamnée pour des crimes violents".








