PHOTOS AFP / MONTAGE PIERRE-OSCAR BRUNET
Candidats, coalitions, résultats... L'article à lire pour tout comprendre des élections en Allemagne
Olaf Scholz va-t-il réussir à se maintenir à la tête de la première puissance européenne? Plus de 59,2 millions d'Allemands sont appelés aux urnes ce dimanche 23 février pour des élections législatives anticipées qui pourraient bien rebattre les cartes du paysage politique. Un scrutin important pour le pays puisqu'il va permettre de faire émerger une nouvelle coalition et d'élire un nouveau chancelier... d'ici plusieurs semaines.
Cette année, la campagne électorale a été plus courte que d'habitude. Et pour cause, ces élections fédérales, initialement prévues en septembre 2025, sont convoquées plus tôt que prévu en raison de l'effondrement de la coalition gouvernementale d'Olaf Scholz fin 2024, qui a mené à la dissolution du Bundestag par le président fédéral après la perte de confiance du chancelier.
Comment fonctionne ce système électoral complexe? Quels sont les enjeux et les principaux candidats en lice? Quand connaîtra-t-on les résultats définitifs et quand l'Allemagne aura-t-elle un nouveau chancelier? BFMTV.com vous détaille comment va se dérouler ce scrutin qui retient l’attention bien au-delà des frontières allemandes.
· À quoi servent ces élections?
En Allemagne, les élections législatives ont normalement lieu tous les quatre ans. Mais cet appel aux urnes anticipé a pour objectif de renouveler les 630 sièges du Bundestag, le Parlement fédéral, afin de dégager une nouvelle majorité stable.
Cette crise politique a été déclenchée en fin d'année dernière par des divergences au sein de la coalition gouvernementale, principalement sur les questions économiques et budgétaires. Le chancelier Olaf Scholz a limogé le ministre des Finances Christian Lindner, une décision qui a entraîné la dissolution de la coalition tripartite formée en 2021, composée du Parti social-démocrate (SPD), des Verts et du Parti libéral-démocrate (FDP).
Ainsi, les résultats attendus dimanche devraient permettre l'émergence d'une nouvelle majorité qui permettra de former une coalition entre les différentes forces politiques, d'élire un nouveau gouvernement et un nouveau chancelier. Une fois constituée, cette majorité sera essentielle pour adopter des décisions législatives cruciales pour l'avenir du pays.
· Qui sont les candidats à la chancellerie?
Friedrich Merz, le conservateur
C'est le grand favori de ces élections. Il est le candidat à la chancellerie du parti chrétien-démocrate CDU-CSU (la formation politique de l'ancienne chancelière Angela Merkel). Pendant cette campagne brûlante, le millionnaire de 69 ans a appelé les Allemands à lui confier un mandat fort pour "résoudre les deux grands problèmes du pays, la migration et l'économie".
Le conservateur qui accuse le gouvernement Scholz de laxisme, a durci sa position sur les questions de sécurité et d'immigration, et il a promis de rebâtir la force industrielle du pays en abaissant les impôts des entreprises et réduisant la bureaucratie. Son objectif: gouverner avec un seul parti pour retrouver une stabilité qui a tant fait défaut à la coalition d'Olaf Scholz avec les Verts et les Libéraux, conduisant à son implosion fin 2024.

Olaf Scholz, le social-démocrate
C'est l'actuel chancelier. Particulièrement impopulaire depuis l'échec de la coalition tricolore, il est à nouveau candidat pour le parti social-démocrate, le SPD. Relégué en 3e place des sondages, ce vétéran de la scène politique de 66 ans pourrait voir sa carrière politique prendre fin dimanche, si les prédictions des sondages se confirment. Son parti pourrait encaisser dimanche son pire résultat de l'après-guerre, et lui a déjà exclu d'entrer dans un gouvernement dirigé par Friedrich Merz.
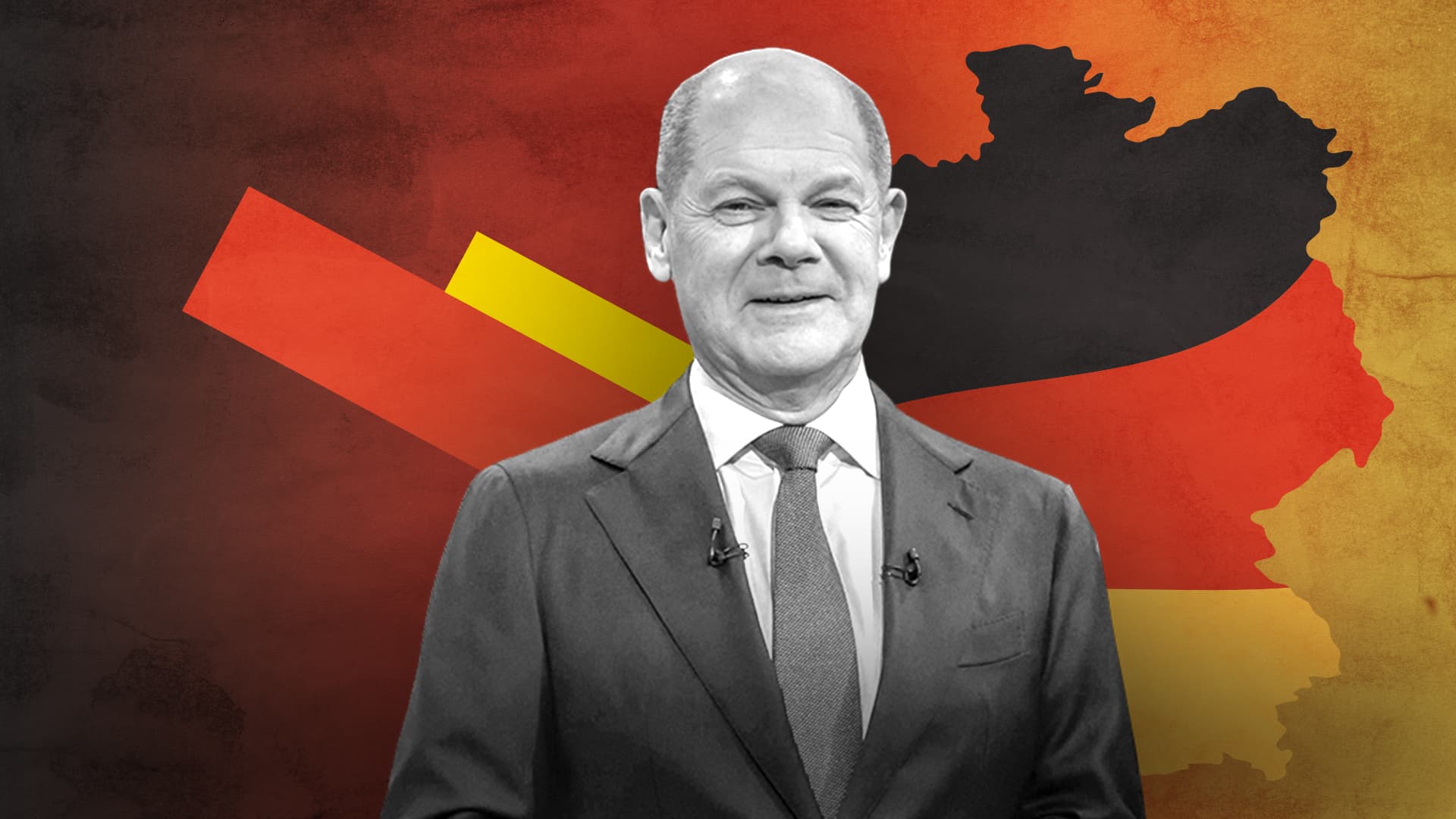
Alice Weidel, le visage de l'extrême droite
C'est la candidate à la chancellerie du parti d'extrême droite AfD (Alternativ für Deutschland, "Alternative pour l'Allemagne), qui se place en 2e position des intentions de vote. Cette ancienne banquière de 46 ans, qui capitalise sur le climat de mécontentement social et politique, a récemment reçu le soutien du milliardaire américain Elon Musk, proche de Donald Trump.
Aujourd'hui, elle cherche à renforcer sa présence au Bundestag mais elle ne risque pas d'entrer au gouvernement puisqu'en raison de ses positions radicales: aucune autre formation politique ne souhaite à ce stade s'allier à l'AfD pour former une coalition.

Des représentants d'autres partis
Enfin, un certain nombre de petits partis cherchent à se faire une place pendant ce scrutin. Parmi eux, les Verts (die Grünen) menés par Robert Hadeck et le parti des Libéraux-Démocrates (FDP) de Christian Lindner, bien qu'ils ne soient pas nouveaux, aspirent à influencer le résultat et à jouer un rôle clé dans la constitution d'une coalition. D'autres formations comme le Parti pirate ou le parti de gauche Die Linke espèrent également obtenir davantage de sièges pour peser sur les débats parlementaires.
Malgré leur taille, ces partis peuvent jouer un rôle déterminant en fonction des résultats, notamment en apportant leur soutien à une coalition minoritaire ou en devenant des acteurs de compromis dans un paysage politique fragmenté.
· Comment les Allemands vont-ils les départager?
Le système électoral allemand - un mode de scrutin mixte à finalité proportionnelle - est beaucoup plus complexe que celui de la France. Concrètement pour les législatives, les électeurs allemands ont deux choix à faire:
- Ils doivent d'abord choisir un candidat parmi celles et ceux de leur circonscription. Dans ce scrutin à un seul tour, celui qui obtient le plus de voix est directement élu pour représenter sa région au Bundestag. 299 représentants sont élus par ce biais
- Dans le même temps, les électeurs sont appelés à cocher une deuxième case sur leur bulletin de vote. Là, ils choisissent un parti politique plutôt qu’un candidat spécifique. Cette voix sert à déterminer la répartition proportionnelle des 331 sièges restants.
Une fois les résultats consolidés, chaque parti se voit attribuer des sièges au Parlement en fonction du pourcentage de voix qu'il a obtenu - à condition de dépasser le seuil des 5%.
Avec ce système, il est compliqué pour les partis d'atteindre seuls le seuil de la majorité absolue au Bundestag. Dans la plupart des cas, cela nécessite la formation d'une coalition. C'est la raison pour laquelle les Allemands ont "la culture du compromis", explique à BFMTV.com Martin Baloge, enseignant-chercheur de l'Université catholique de Lille et spécialiste de la vie politique allemande, qui poursuit.
"Plutôt que se retrouver dans une situation comme en France où on ne sait pas si le gouvernement va passer le mois, en Allemagne on va devant le Bundestag pour élire le chancellier qu'une fois qu'on a trouvé la coalition qui est sûre de tenir, qu'un contrat de coalition sur lequel les partis se mettent d'accord afin que le gouvernement ne soit pas renversé", détaille-t-il.
· Quels ont été les thèmes de campagne?
La campagne électorale s’est focalisée sur les questions de sécurité, de migration et de droit d'asile cette année, en grande partie en raison de l'actualité qui a été marquée par une série d'attentats et d'attaques au couteau commises par des ressortissants étrangers. Bien que le caractère terroriste n'ait pas été retenu pour certains de ces actes, ils ont occupé une place centrale dans les débats.
L'économie, et plus particulièrement la question du frein à l'endettement, a également été un sujet majeur, mettant en évidence d'importantes divergences idéologiques entre les candidats. La "règle d'or" limitant les emprunts à 0,35% du PIB suscite des débats: les libéraux s’opposent à toute réforme, la CDU est ouverte à des discussions, et le SPD plaide pour un assouplissement pour relancer l’économie avec des investissements massifs.
Les questions environnementales et sociales, elles, ont été quasi absentes des débats. En revanche, la guerre en Ukraine a pris une place importante. Trois ans après l'invasion russe, l'Allemagne reste divisée sur les armes à fournir et le financement de l'aide, malgré un soutien quasi-unanime à Kiev.
· Que disent les sondages?
Le conservateur Friedrich Merz est clairement le favori des sondages et pourrait devenir le prochain chancelier en Allemagne. Dans les sondages d'intentions de vote relayés par la chaîne publique allemande ZDF, le camp conservateur CDU/CSU arrive en tête avec environ 30% des intentions de vote, suivi de l'extrême droite AfD (20-22%), des sociaux-démocrates SPD (15-16%) et des Verts (13-14%).
Quant aux libéraux du FDP, qui ont claqué la porte du gouvernement de Scholz en novembre, et le BSW, parti populiste de gauche créé il y a un an, ils flirtent avec le seuil des 5% de voix nécessaires pour siéger à la chambre basse du parlement, rendant incertaine leur qualification.
· L'extrême droite peut-elle arriver au pouvoir?
Pour le spécialiste Martin Baloge, la réponse est clairement non. "Elle ne gouvernera pas, elle n'entrera pas au gouvernement", tranche-t-il. "Mais elle devrait normalement faire une percée assez forte en terme de sièges et elle devrait selon toute vraissemblance devenir le premier parti d'opposition numériquement, ce qui va lui donner certains pouvoirs dans les commisions parlementaires par exemple."
En effet, l'AfD pourrait se voir renforcé dans les groupes de parlementaires qui examinent les projets de loi et les propositions du gouvernement car les partis d'opposition, surtout les plus importants numériquement, ont souvent un rôle clé dans ces commissions. Ils peuvent proposer des amendements, poser des questions aux ministres et exercer une forme de contrôle sur le travail gouvernemental.
Si elle ne risque pas d'accéder au pouvoir, l'AfD entend jouer un rôle assez proche de celui du Rassemblement national en France actuellement. "Soit elle va chercher à infuser idéologiquement sur le gouvernement CDU, soit elle continuera à développer sa rhétorique anti-partis dans son coin", estime le spécialiste de la vie politique allemande.
· Quelles sont les coalitions possibles?
L'option la plus probable reste la "grande coalition" entre la CDU/CSU et le SPD, qui a déjà été utilisée dans le passé pour garantir une stabilité gouvernementale.
L'autre possibilité - qui a été beaucoup discutée ces dernières semaines en Allemagne - est la coalition noire-verte (entre la CDU/CSU et les Verts), bien que cette alliance soit compliquée en raison des divergences idéologiques entre les partis, notamment sur les questions écologiques.
Une coalition rouge-rouge-verte (SPD, Die Linke, les Verts) pourrait également émerger, mais les tensions entre les sociaux démocrates et Die Linke rendent cette option plus difficile.
Une autre combinaison moins probable est possible avec la coalition "Jamaïque" (CDU/CSU, FDP, les Verts). Celle-ci réunirait des partis de centre-droit, libéraux et écologistes, mais une fois encore cela pourrait se heurter à des obstacles idéologiques, surtout entre les Verts et les Libéraux.
Enfin, si aucun des partis ne parvient à obtenir une majorité absolue, une coalition de minorité pourrait être envisagée, où un ou plusieurs partis gouverneraient sans majorité stable, cherchant des compromis avec d'autres groupes au Parlement.
Les petits partis comme Die Linke, les Libéraux ou d’autres mouvements émergents pourraient également jouer un rôle important dans la formation d’une coalition. L'AfD, en revanche, reste pour l'heure exclue des négociations: aucun parti ne souhaite s'allier avec le mouvement d'extrême droite à ce stade.
• Quand connaîtra-t-on les résultats?
Les résultats des élections fédérales seront dévoilés progressivement à partir de la fermeture des bureaux de vote, dimanche 23 février dans la soirée.
Quant au nom du nouveau chancelier, difficile de le dire. "Le compromis, ça peut prendre beaucoup de temps", rappelle le spécialiste de l'Allemagne Martin Baloge. Lors des dernières élections de 2021, il a fallu dix semaines au total pour former la coalition du chancelier Scholz, entre son parti, les sociaux-démocrates, les Verts et les Libéraux. Ce délai de deux mois et demi pour former un gouvernement se situe "dans la fourchette habituelle", a expliqué à l'AFP Uwe Jun, professeur de sciences politiques à l'université de Trèves.
Il peut parfois être plus long: en 2017, les conservateurs d'Angela Merkel avaient mis six mois à former une coalition avec les sociaux-démocrates.









