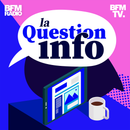Canada, Groenland, Panama: que cherche Trump en menaçant d'annexer ces territoires?

Des propos qui laissent présager d'un mandat agité sur la scène internationale. Lors d'une conférence de presse donnée dans sa résidence de Floride, Donald Trump a détaillé ce mardi 6 janvier ses ambitions en matière de politique étrangère en multipliant les déclarations provocatrices à l'égard de territoires qu'il aimerait voir revenir dans le giron américain.
Dans un mélange de menaces et de provocations, il a répété ses revendications territoriales sur le canal de Panama ou encore le Groenland. Alors qu'on lui demandait s'il pouvait garantir qu'il n'aurait pas recours aux forces armées pour annexer l'artère vitale du transport maritime mondial et le territoire autonome du Danemark, Donald Trump a répondu: "Je ne peux pas vous l'assurer, sur aucun des deux."
"Nous ne sommes plus stupides à présent"
Le président élu a déjà affirmé à plusieurs reprises vouloir reprendre le canal de Panama, construit par les États-Unis et inauguré en 1914, si le prix des péages pour les navires américains n'était pas réduit. Il a encore fustigé mardi l'accord passé en 1977 par le président d'alors Jimmy Carter, qui a abouti à un transfert du contrôle du canal au Panama en 1999.
"Ils ne nous traitent pas de manière juste. Ils font payer nos navires davantage que les navires d'autres pays", a lancé Donald Trump. "Ils se moquent de nous parce qu'ils pensent que nous sommes stupides. Mais nous ne sommes plus stupides à présent", a-t-il encore déclaré.
"Joyeux Noël à tous, y compris aux merveilleux soldats chinois qui exploitent avec amour, mais illégalement, le canal de Panama", avait-il déjà écrit, fin décembre, dans un post menaçant sur son réseau Truth Social. Le Panama "nous arnaque", avait-il asséné, "bien au-delà de leurs rêves les plus fous".
"Donald Trump a l'habitude de menacer pour obtenir un deal", décrypte sur notre antenne la chercheuse Cécile Coquet-Mokoko. Pour la professeur de civilisation américaine à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, ces déclarations à l'emporte-pièce s'inscrivent dans la volonté de "mettre les intérêts de l'Amérique en premier".
Le Groenland, une "nécessité"
Dans ce même message de fin d'année publié sur Truth, le 47e président américain avait également jugé que le contrôle du Groenland était "une nécessité absolue" pour "la sécurité nationale et la liberté à travers le monde".
Ce mardi, il a à nouveau exhorté le Danemark à "renoncer" à ce territoire autonome. Le même jour, son fils, Donald Trump Jr, était justement au Groenland pour une visite privée en tant que "touriste".
L'intérêt du milliardaire pour la plus grande île du monde n'est pas nouveau. En 2019 déjà, celui qui était alors le 45ème président américain avait envisagé d'acheter le territoire qui est sous souveraineté danoise depuis 1814.
Plus tôt dans l'histoire, c'est l'ancien président américain Harry Truman qui avait des vues sur le Groenland. La Maison Blanche avait alors fait une offre d'achat de 100 millions de dollars au Danemark qui l'avait refusée. Le pays scandinave avait déjà repoussé une offre similaire en 1867 quand l'Amérique d'Andrew Johnson avait souhaité acquérir le territoire après le rachat de l'Alaska à la Russie pour 7 millions de dollars.
Le territoire autonome danois, qui cherche à gagner en souveraineté mais reste financièrement dépendant de Copenhague, attise les convoitises pour ses ressources naturelles et pour son importance géostratégique - les États-Unis y ont déjà une base militaire.
"Avec le dégel lié au réchauffement climatique, des routes de l'Asie vers l'Europe vont s'ouvrir", analyse sur BFMTV notre consultant défense Jérôme Clech. "Il y a des enjeux d'approvisionnement en énergie et en matériaux critiques qui se jouent au pourtour de l'Arctique", raison pour laquelle Donald Trump veut garder le "contrôle" sur la région, poursuit notre spécialiste.
Canada, un "51e État"
Donald Trump a également réitéré son envie de faire du Canada le "51e État" américain. Une idée qu'il avait déjà suggéré à Justin Trudeau début décembre, quand celui qui était encore Premier ministre du Canada était venu lui rendre visite chez lui en Floride.
Mardi, le républicain a menacé de faire usage de la "force économique" contre son voisin canadien, un allié "subventionné" par les États-Unis pour sa protection, selon lui. Quelques heures plus tard, il publiait sur son réseau Truth Social une carte des États-Unis incluant le territoire canadien.
La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, lui a répondu que le Canada ne reculerait "jamais face aux menaces", tandis que Justin Trudeau a ajouté: "Jamais, au grand jamais, le Canada ne fera partie des Etats-Unis".
"Meuf, tu n’es plus le gouverneur du Canada, ce que tu dis n’a donc aucune importance", lui a rétorqué le milliardaire et proche soutien de Donald Trump Elon Musk, qui multiplie sur son réseau X les attaques contre les dirigeants occidentaux.
Avant même sa prise de fonction le 20 janvier, le président élu avait menacé de taxer à 25% les produits canadiens et mexicains, une décision justifiée selon lui par les crises liées aux opiacés - en particulier le fentanyl - et à l'immigration.
"Donald Trump veut obtenir des deals qui soient favorables à l'indépendance énergétique des États-Unis, en particulier en matière de pétrole et pour le Canada, en matière de gaz de schiste", interprète pour BFMTV Cécile Coquet-Mokoko.
Trump, "pas un isolationniste"
Selon Maud Quessard, chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire (Iresm), toutes ces déclarations "montrent que Donald Trump n'est pas isolationniste comme on a trop tendance à le dire".
"Il est dans une compétition avec la Chine et la Russie qui sont deux puissances expansionnistes. Il tient à raconter une histoire concurrente de celles que peuvent raconter Xi Jinping et Vladimir Poutine", poursuit auprès de BFMTV.com la spécialiste de la politique étrangère américaine.
Pour Maud Quessard, le récit que tente d'écrire Donald Trump peut plaire à son électorat car il renoue avec des heures glorieuses de l'histoire américaine. "Il veut s'inscrire dans les pas de Theodore Roosevelt, au début du XXe siècle, qui était un président impéraliste avec un projet fort pour son pays", analyse-t-elle.
Mais pour ce faire, le républicain "ne parle pas de l'Europe ou du Moyen-Orient", relève-t-elle. "Il parle de territoires géographiquement proches des États-Unis, qui parlent aux Américains".
Donald Trump est-il pour autant prêt à s'emparer de nouveaux territoires par la force? "On est dans la stratégie de la pression maximale", estime Maud Quessard. "Il ne dit pas qu'il va engager l'armée pour redessiner les frontières, mais il veut montrer par des démonstrations de force qu'il est prêt à garantir ses intérêts".