La COP26 débute: à quoi ont servi les 25 autres conférences sur le climat?
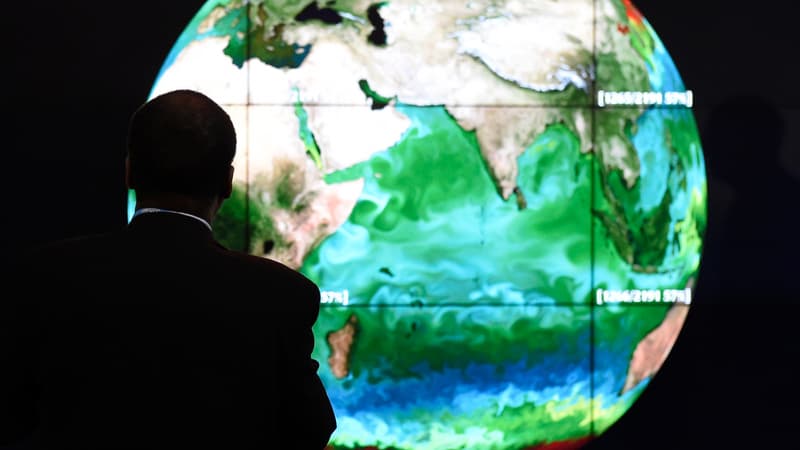
Un invité de la Cop21 contemple une projection du globe terrestre, le 30 novembre 2015 - Alain Jocard - AFP
Ils seront des dizaines de milliers, réunis pour réfléchir à l'avenir de la planète. La très attendue COP26, reportée d'un an en raison de la pandémie de Covid-19, s'ouvre ce dimanche à Glasgow (Écosse), jusqu'au 12 novembre. C'est, comme son nom l'indique, la 26ème de ces "conferences of the parties", organisées chaque année depuis 1995, dans le but de lutter contre le dérèglement climatique.
La rencontre se tient quelques mois après une nouvelle "alerte rouge" du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat): les scientifiques ont annoncé une hausse "sans précédent" des événements météorologiques extrêmes dus à la crise climatique, pointant la responsabilité "sans équivoque" de l'humain dans ces phénomènes.
Malgré ces rendez-vous internationaux annuels, malgré les mesures dégagées par les Accords de Paris lors de la COP21, la situation continue donc de se dégrader, et les pires scénarios des climatologues sont en train de se réaliser, ce qui peut interroger sur l'efficacité - et donc l'utilité - des COP.
"L'enjeu, c'est de dépasser les frontières"
"Sur le climat, les premières alertes sont données dans les années 1970 et un premier rapport du GIEC en 1990" évoque déjà l'impact de l'activité humaine sur le climat, rappelle à BFMTV.com le climatologue Jean Jouzel, ancien vice-président du GIEC, et auteur de Climat: Parlons vrai.
Dans ce rapport, on peut déjà lire que "les émissions résultant des activités humaines augmentent considérablement les concentrations atmosphériques des gaz à effet de serre" sur la planète.
Ce rapport entraîne la mise en place de la CCNUCC (convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques) à Rio de Janeiro (Brésil), en 1992. Elle a pour objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre "à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique (due à l'activité humaine, NDLR) dangereuse du système climatique", précise l'ONU. Les signataires de la CCNUCC sont les fameuses "parties" présentes aux COP. Elles sont actuellement 197 (196 États et l’Union européenne).
"Le but ultime des COP, c'est de réussir à éviter le dérèglement climatique", résume pour BFMTV.com Estelle Forget, consultante climat, qui a travaillé au secrétariat général de la COP21.
"L'enjeu, c'est de dépasser les frontières", ajoute Frédéric Amiel, coordinateur général des Amis de la Terre en France, une fédération internationale de protection de l'homme et de l'environnement. "C'est seulement à un échelon mondial que l'on peut faire avancer les choses, on ne pourra pas régler le changement climatique au niveau d'un pays."
Kyoto, Copenhague, Paris... 3 COP majeures
"Toutes les COP n'ont pas eu la même importance", note Jean Jouzel. Ainsi, si on compte 26 COP depuis 1995 trois sont particulièrement notables. Il y a d'abord la COP3, au Japon, qui a entériné les accords historiques de Kyoto en 1997.
Par ce traité, "38 pays industrialisés s’engagent à une réduction moyenne de 5,2% de leurs émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 2012" par rapport à celles de 1990, rappelle le site du gouvernement français. Il s'agit du "premier traité international juridiquement contraignant contre le réchauffement climatique".
Mais parmi les signataires, on ne retrouve ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie, qui refusent cet engagement, alors qu'ils font partie des pays les plus pollueurs en terme de CO2.
L'autre COP qui marque l'histoire, c'est la COP15 de Copenhague (Danemark) en 2009. Mais contrairement à Kyoto, "c'est un échec", déclare à BFMTV.com Gilles Ramstein, directeur de recherches au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement: "Elle devait décider de ce qui devait se passer après Kyoto, mais les pays présents n'ont pas réussi à se mettre d'accord." Les discussions n'ont toutefois pas été totalement vaines, car à Copenhague "et lors des COP qui ont suivi, elles ont permis de convaincre pour les Accords de Paris, lors de la COP21".
Ratifiés par 191 parties, les Accords de Paris de 2015 confirment notamment l’objectif de maintenir le réchauffement climatique sous les 2°C et appellent à poursuivre les efforts pour limiter la température en deçà de 1,5°C. Il prévoit également la neutralité des émissions carbone pour 2050, sauf pour la Chine qui vise 2060.
"La COP21 est un succès par son universalité, tout le monde a mis des engagements, tout le monde a signé, a ratifié", déclare Jean Jouzel.
Les autres COP ont contribué, petit à petit, à préparer ces grands accords, en refaisant à chaque fois le point sur la situation. Elles sont aussi l'occasion d'avancer sur des dossiers techniques particuliers. La COP16 de Cancun (Mexique) a par exemple permis la concrétisation du Fonds vert pour le climat, qui vise à transférer des moyens financiers des pays les mieux dotés vers les pays les plus vulnérables pour mettre en place des projets contre le réchauffement climatique.
"Faire converger des intérêts divergents"
S'il a fallu tant d'années pour que près de 200 parties signent un accord commun, c'est parce que chaque État a un fonctionnement énergétique particulier et des enjeux qui lui sont propres. "En France la part du nucléaire est forte alors qu'en Pologne c'est le charbon", note par exemple Gilles Ramstein.
Sans compter les changements de gouvernance, qui peuvent venir bouleverser les engagements. Le président américain Donald Trump avait ainsi quitté les Accords de Paris lors de son mandat, refusant de mettre en œuvre les promesses de son prédécesseur Barack Obama.
"Depuis leur création, la difficulté des COP, c'est de faire converger des intérêts divergents", souligne Estelle Forget. "Se mettre d'accord sur un programme commun est très difficile et prend du temps".
En plus des délégations de chaque pays, qui peuvent déjà être en désaccord, les COP rassemblent des membres de la société civile, des associations, des ONG, des entreprises ou encore différents lobbies présents comme observateurs, mais qui peuvent parfois intervenir. C'est un réseau complexe de dizaine de milliers de personnes aux intérêts discordants, et de ce nœud doivent sortir des accords.
Les COP sont "un vrai forum de négociations. Et comme cela dure 15 jours, il est vraiment possible de réussir à faire évoluer les avis de certains acteurs dans un sens ou dans un autre", assure Frédéric Amiel. Même si le plus souvent, reconnaît-il, "c'est à la marge que cela se joue, sur un paragraphe, on négocie sur des virgules".
Des promesses tenues?
Il y a de l'ambition dans les promesses signées en 2015, assurent les spécialistes interrogés, mais encore faut-il les réaliser. Si dès Kyoto, "tout le monde avait signé et respecté ces accords, peut-être n'en serions-nous pas là aujourd'hui", déclare Jean Jouzel. Le climatologue rappelle que des années 1970 à la fin des années 2010, "les émissions de gaz à effet de serre ont doublé" dans le monde.
En ce qui concerne les Accords de Paris, "l'Europe a tenu ses engagements pour 2020 de diminuer de 20% ses émissions de gaz à effet de serre", souligne le climatologue, mais "son empreinte carbone a nettement augmenté dans le même temps". Il "espère" que l'UE respectera les prochains: une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici 2030, par rapport aux niveaux de 1990.
"Il faudrait que les émissions mondiales baissent de plus de 40% d'ici 2030, alors qu'elles augmentent actuellement", note également Jean Jouzel.
Pour vraiment avoir une incidence sur le changement climatique, "cela implique de tout changer, de revoir le système énergétique, mais aussi celui des transports publics, de l'isolement des bâtiments", souligne Gilles Ramstein. Or, le spécialiste ne voit pas pour le moment de "plan à long terme qui permettrait d'arriver à cela".
Les COP "participent à faire avancer le débat"
Les experts ne remettent pas pour autant en cause l'intérêt de ces rendez-vous. "Cela entraîne des engagements, des réflexions qui ne se mettraient pas en place si on n'en parlait pas tant" déclare Jean Jouzel. Avec les COP, "il y a une vraie interaction entre ce que font les scientifiques dans le cadre du GIEC et la réalité, elles ont permis de faire prendre la mesure de ce qui allait arriver", abonde Gilles Ramstein.
"Les engagements pris lors des COP sont des référentiels importants sur lesquels peuvent appuyer les contre-pouvoirs", déclare Frédéric Amiel. Et "même si aujourd'hui les résultats des COP ne sont pas forcément visibles, elles participent à faire avancer le débat sur le changement climatique."
La COP26 qui s'ouvre ce dimanche pourrait faire partie des rendez-vous qui comptent, car les parties présentes doivent y "annoncer leurs nouveaux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre", explique le ministère de la Transition écologique. Mais la pandémie de Covid-19, qui a bouleversé les instances mondiales, et surtout ses conséquences économiques, promettent d'influencer les prochaines discussions. Et donc l'ambition de l'accord qui pourrait en découler.









