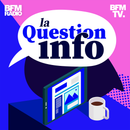Famille tuée à Meaux: le suspect, atteint de troubles psychiatriques, pourra-t-il être jugé?
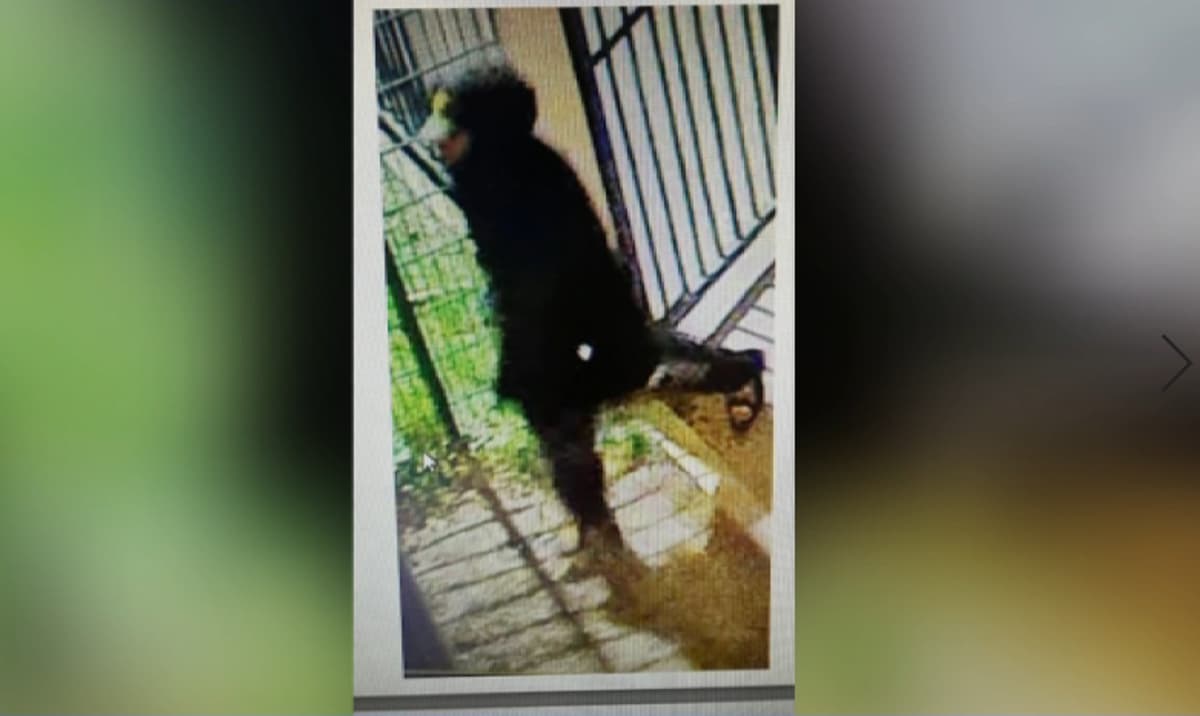
Le suspect du quintuple homicide à Meaux (Seine-et-Marne) sera-t-il jugé? Deux jours après le crime, l'enquête se concentre sur le profil psychiatrique du suspect, soupçonné d'avoir tué sa femme et leurs quatre enfants dans leur appartement lundi 25 décembre. Depuis 2017, cet homme de 33 ans est suivi pour des troubles dépressifs et psychotiques, ce qui pose la question de son irresponsabilité pénale - ses troubles ayant pu altérer ou abolir son discernement.
Selon les premiers éléments de l'enquête, le père de famille a déjà fait plusieurs tentatives de suicide, en 2017 et en 2019. Il souffre notamment de dysthymie, un trouble persistant de l'humeur, considéré comme une "dépression mineure chronique".
Lors de la perquisition du domicile familial, les enquêteurs ont retrouvé "des documents administratifs pouvant évoquer un internement de nature psychiatrique en 2017" et "des ordonnances de prescription de tranquillisants", a précisé le procureur de la République de Meaux, Jean-Baptiste Bladier,lors d'une conférence de presse mardi.
Il avait également été hospitalisé en psychiatrie pendant deux mois, après avoir blessé au couteau sa compagne, alors enceinte de 8 mois, en 2019. La mère, qui n'avait pas voulu porter plainte, "évoquait un état dépressif ancien chez son conjoint qui, selon elle, avait interrompu son traitement il y a quelque temps", a ajouté le procureur. Déclaré déficient mental, il avait été considéré comme irresponsable de ses actes et la procédure avait été classée sans suite.
Une bouffée délirante?
Dans cette nouvelle affaire, ce sont des experts psychiatriques, mandatés par la justice, qui vont devoir déterminer si le discernement du suspect était aboli ou altéré au moment des faits.
Ces derniers vont devoir se poser plusieurs questions. "D'abord, le sujet est-il atteint d'une maladie mentale telle que la schizophrénie, la psychose paranoïaque ou le délire chronique qui mettent les gens en dehors de la réalité?", avait détaillé à BFMTV.com, dans un précédent article, Roland Coutanceau, psychiatre et expert judiciaire auprès des tribunaux.
"Ensuite, si une maladie mentale est décelée, on se demande si au moment des faits, cette pathologie était en poussée aiguë, c'est-à-dire: le patient était-il en proie à une bouffée délirante? Enfin, on se demande si ces éléments délirants ont sous-tendu le passage à l'acte. Ce serait l'exemple d'une personne qui a l'impression que son voisin est possédé par le diable, il ne le voit plus comme un être humain. Dans son délire, il veut s'attaquer au diable", avait-il poursuivi.
"La dépression à elle seule ne favorise pas une telle violence et un tel acharnement contre sa femme et ses enfants", a commenté Laure Westphal, psychologue clinicienne au GHU Paris psychiatrie et neurosciences au micro de BFMTV.
Les réponses du suspect décortiquées
"Là, c’est clairement une décompensation psychotique dont il s'agit", estime la spécialiste. "Quelqu'un de psychotique peut "fabriquer des angoisses massives extrêmement importantes (...) si massives que la personne peut halluciner, développer un délire et se sentir persécuté", a-t-elle ajouté.
Selon le psychologue Olivier Dubois, c'est aussi la manière "dont la personne répond, si elle est inadaptée dans sa réponse, qui détermine le plus l’altération de la compréhension ou de la réalité".
"L’expertise va tenir compte des réponses du sujet", a précisé le psychologue, ce mercredi, sur BFMTV. "Par exemple, s'il dit 'le monde va mal, la société est inadaptée, j’entendais des voix qui me disaient attention ta famille et tes enfants sont en très grand danger, il faut les protéger', ce genre de réponse signerait l’altération de la pensée du sujet." À la mi-journée ce mercredi, le suspect n'avait toujours pas été entendu, les enquêteurs attendant le feu vert d'un médecin pour démarrer son audition.
Des peines différentes
Si ces expertises sont cruciales, c'est que les peines encourues ne sont pas les mêmes. "La réponse pénale va être totalement différente en fonction de ce vers quoi l’expertise psychiatrique va s’orienter", a expliqué l'avocate pénaliste Juliette Bissière ce mercredi sur BFMTV.
Une information judiciaire ayant été ouverte pour homicides volontaires sur mineurs et homicide volontaire par conjoint, l'homme risque la réclusion criminelle à perpétuité, s'il est déclaré responsable de ses actes. Si son discernement est considéré comme altéré au moment des faits, la peine est réduite. Il risque jusqu'à trente ans de réclusion criminelle.
"Si c’est une altération, on considère que le discernement a été obscurci, mais pas totalement aboli, et donc la personne va devoir répondre de ses actes et être jugée. En revanche, il n’y aura pas de réponse médicale", a détaillé l'avocate.
En revanche, si son discernement est aboli, il sera déclaré irresponsable de ces actes et aucune peine ne pourra être prononcée. Selon l'article 122-1 du Code pénal, "n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes".
En revanche, dans cette situation, il peut y avoir une audience devant la Cour d’appel pour que les parties civiles soient reconnues en tant que victimes.
200 décisions par an
Si la Cour d'appel ne peut pas prononcer de mesures privatives de liberté, elle peut décider de mesures de sûreté comme une hospitalisation d'office, une interdiction d'entrer en contact avec les victimes ou les proches de victimes, une mesure d’éloignement ou une annulation ou suspension du permis de conduire.
Ces mesures de sûreté peuvent être prononcées pour une durée de dix ans en cas de délit ou vingt ans en cas de crime. Concernant l'hospitalisation d'office, la justice ne peut pas ordonner de durée, ce sont les médecins qui décideront en fonction de l'état du patient.
Ce sont ces mêmes médecins qui peuvent donner leur feu vert à une libération, s'ils estiment que l'état de santé de la personne est compatible avec un retour à la vie civile. Si une libération est décidée, le préfet du département dans lequel la personne est internée peut s'y opposer.
Selon nos informations, entre 2017 et 2021, la justice a prononcé 1.086 décisions d'irresponsabilité pénale, soit environ 200 par an en moyenne. Parmi elles, 350 des décisions d'irresponsabilité pénale concernaient des affaires criminelles, 736 des affaires délictuelles.
Rien qu'en 2021, 73 décisions d'irresponsabilité pénale criminelle ont été rendues par la justice. Néanmoins, elles ne représentent qu'une part infime sur l'ensemble des décisions de justice rendues.