Menace nucléaire en Ukraine: pourquoi il est si difficile pour l'AIEA de surveiller les centrales en temps de guerre
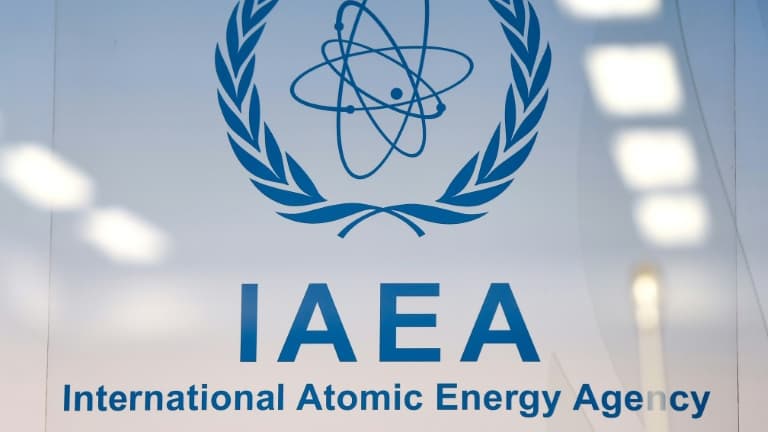
Le logo de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), à son siège à Vienne, le 1er mars 2021 - JOE KLAMAR © 2019 AFP
Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'armée russe a pris le contrôle de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia. Des tirs ont même visé un bâtiment adjacent aux six réacteurs que compte le complexe, sans toutefois entraîner de fuites radioactives. Face à la gravité sans commune mesure de cette situation, les regards se sont immédiatement tournés vers Vienne, siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
"Il faut comprendre que nous faisons face à une situation inédite. Habituellement, en diplomatie, il convient de regarder dans le passé pour y trouver des solutions. Ici, nous évoluons en eaux troubles", a reconnu Rafael Mariano Grossi, directeur de l'Agence, lors d'une conférence de presse organisée en urgence vendredi matin.
Une agence sans réel pouvoir de contrainte
Un aveu d'impuissance? Avec la prise de Zaporijjia, l'armée russe a en tout cas marqué un précédent dans l'histoire des conflits armés. C'est en effet la première fois qu'un pays prend possession d'une installation nucléaire civile ennemie. Le 24 février, c'est la zone protégée de l'ancienne centrale de Tchernobyl qui était également passée sous contrôle russe.
"Malheureusement, l'AIEA n'a pas de pouvoir de contrainte. On peut l'assimiler à l'ONU. En temps de paix, c'est bien. Mais malheureusement, en temps de guerre, elle a peu de pouvoir d'influence", reconnaît Emmanuelle Galichet, enseignante chercheuse en sciences et technologies nucléaires au Conservatoire national des arts et métiers, contactée par BFMTV.com.
Créée en 1957, l'AIEA est une organisation internationale placée sous l'égide de l'ONU. Son objectif principal est de promouvoir les usages pacifiques de l'énergie nucléaire, et de limiter le développement de ses applications militaires. Elle possède 173 membres, et s'était jusqu'alors principalement manifestée en Iran, pays accusé d'enrichir son uranium civil à des fins militaires.
"L'AIEA travaille sur tout ce qui a trait avec le nucléaire. Civil, militaire, mais aussi médical. Des pays du monde entier y envoient leurs experts, qui sont censés partager les informations et intentions de leur pays dans ce domaine", analyse pour BFMTV.com Geneviève Baumont, qui a officié pendant 40 ans à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Problème: les experts russes n'ont jamais fait état de leur intention de s'emparer de sites nucléaires ukrainiens auprès de l'AIEA. Ce vendredi matin, Rafael Mariano Grossi a révélé "qu'il y a quelques jours, j'ai réuni notre conseil des gouverneurs (dont fait partie la Russie, NDLR). J'ai rappelé une liste de principes. (...) Toutes les personnes présentes se sont mises d'accord, sans exception, pour dire que ces principes devaient être maintenus. Cependant, ce vendredi, le premier de ces principes, qui concerne le respect de l'intégrité physique des installations nucléaires, a été compromis par la Russie. Les mots ont un sens".
Les risques d'un déplacement sur place
Face à l'attitude russe, le diplomate argentin l'a promis: "Il est venu le temps de l'action." Comment? En se rendant sur place, afin de réaliser des contrôles de radioactivité. Notamment dans la zone protégée de Tchernobyl, elle aussi désormais sous contrôle russe depuis le tout début de la guerre.
"J'ai indiqué à la Russie et aux Ukrainiens ma disposition à voyager vers Tchernobyl dès que possible", a souligné Rafael Mariano Grossi.
Une annonce qui suscite un certain scepticisme par les deux expertes interrogées par BFMTV.com. "Par temps de guerre, tout est chamboulé. Oui, l'AIEA pourrait y envoyer des experts. Mais encore faut-il réussir à les acheminer dans ces conditions", soulève Geneviève Baumont.
Même constat pour Emmanuelle Galichet. "Le réseau européen de mesure est déjà très efficace, et nous permet de dire qu'il n'y a pas eu de remontée de la radioactivité à Tchernobyl. Alors les experts de l'AIEA peuvent se rendre sur place, mais ils risquent surtout de se prendre une balle perdue", déclare-t-elle, tout en reconnaissant un geste "courageux" dans la proposition de Rafael Mariano Grossi.
Contactée par BFMTV.com, l'AIEA ne donne pas de détails complémentaires concernant ses futures démarches, et renvoie aux propos tenus ce vendredi matin par son président.
Quant à Emmanuelle Galichet, elle fait part d'une dernière réserve dans la démarche de l'organisation. "L'AIEA contrôle en réalité ce qu'on veut bien lui montrer. Rien ne dit que les militaires russes présents sur place seront enclin à montrer l'intégralité des sites nucléaires pris aux Ukrainiens."
De son côté, Rafael Mariano Grossi l'assure: "L'Ukraine a fait une demande d'assistance. Nous ne l'ignorerons pas".








