"Mademoiselle": dix ans après la circulaire qui déconseille son emploi, où en est l'utilisation de ce terme?
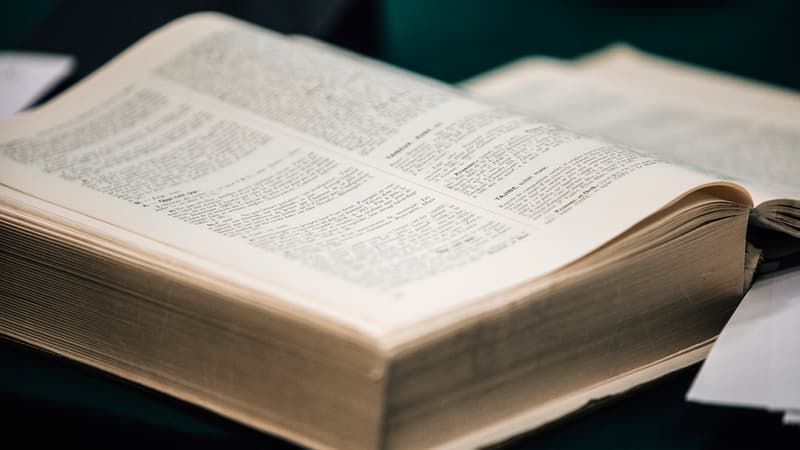
Un dictionnaire présenté à l'Académie française. (Photo d'illustration) - Académie française
Le 21 février 2012, une circulaire du Premier ministre préconisait "la suppression de la case 'mademoiselle' de tous les formulaires administratifs", ce afin de ne plus imposer aux femmes la précision de leur statut marital. "L'emploi de la civilité 'madame' devra donc être privilégié comme l'équivalent de 'monsieur' pour les hommes, qui ne préjuge pas du statut marital de ces derniers", précise la circulaire.
Dix ans plus tard, ce terme n'a toutefois pas disparu de tous les formulaires, et encore moins du langage courant, notent auprès de BFMTV.com plusieurs linguistes.
Pourquoi "mademoiselle" dérange
Si le terme "mademoiselle" est pointé du doigt dans la circulaire, c'est parce qu'il perpétue l'existence d'une société patriarcale dans laquelle il faut préciser si une femme est mariée ou non, car cela modifie ses droits, et son statut dans la société. En ce sens, "c'est un terme sexiste et patriarcal", explique à BFMTV.com Anne Le Draoulec, chercheuse en linguistique au CNRS.
"La distinction entre 'madame' et 'mademoiselle' est la survivance d’une époque où la femme était mineure à vie (code Napoléon, 1804): mademoiselle dépendait de son père, madame de son mari – et il était crucial, administrativement parlant, de le savoir", expliquaient en 2014 Anne Le Draoulec et Marie-Paule Péry-Woodley, linguiste également.
Anne Le Draoulec souligne aussi "qu'il n'y a pas d'équivalent pour l'homme", le terme "damoiseau" ayant disparu du langage. "On peut parler d'équivalent avec le terme 'jeune homme'", mais il s'agit alors moins d'une référence au statut marital qu'à la jeunesse de l'interlocuteur. Aujourd'hui, quand une femme se fait appeler "mademoiselle", s'est d'ailleurs a priori en référence à un âge jugé jeune, et non à son statut marital.
Mais cet usage aussi peut poser problème pour les femmes interpellées ainsi, qui peuvent le ressentir comme de la condescendance. Le "hé mademoiselle" est également associé au harcèlement de rue et à la drague lourde.
Quand quelqu'un emploie le terme "mademoiselle", "l'intention n'est pas forcément insultante, mais pour moi, c'est une façon de prendre le pouvoir", sur la personne interpellée, explique à BFMTV.com Véronique Perry, linguiste féministe. "C'est un titre qui met à disposition" la femme appelée ainsi, et "aujourd'hui, ce n'est pas possible".
Un terme encore bien présent
Le terme reste toutefois régulièrement utilisé. Sur le site de l'Assurance maladie, on peut en effet voir quelques messages de femmes réclamant de ne plus être appelées "mademoiselle" sur les courriers de la Sécurité Sociale. "Les personnes à qui je montre mon attestation n'ont pas à connaître mon statut marital. Ça ne regarde que moi. De plus, je souhaite être adressée par 'Madame'", écrit par exemple une internaute.
Et dans le privé il est également fréquent de tomber dans certains formulaires sur une case "mademoiselle".
Véronique Perry rappelle que la circulaire du gouvernement "n'a pas de valeur juridique, c'est une recommandation forte" et seulement pour les administrations publiques, pas pour le secteur privé. En ce sens, une administration peut décider de continuer à l'utiliser. Si jamais le gouvernement souhaite réellement supprimer ce terme des formulaires administratifs, "il faut que ce soit fait par décret, ou un arrêté", déclare-t-elle.
Le mot "mademoiselle", "semble être moins utilisé qu'avant" note Anne Le Draoulec, notamment par la jeune génération, mais il reste difficile de jauger de la baisse de son emploi depuis 2012 en France. De toute façon, "il n'est pas près de disparaître. Si beaucoup de gens arrêtent de l'employer, cela pourrait arriver, mais aujourd'hui on en est loin", souligne la linguiste. Ce mot est d'ailleurs encore utilisé par des marques pour des noms de produits, ou même dans le cadre de performances artisitiques.
"Ce n'est pas l'écrit qui prescrit"
Si ce terme doit disparaître, ce ne sera en tout cas pas via une circulaire, expliquent les deux linguistes. Cette recommandation a pu accélérer un peu les pratiques administratives, influencer certaines entreprises privées sur le sujet, ou tout simplement notifier publiquement la désuétude du terme, mais "une circulaire ne peut pas codifier le langage courant", souligne Anne Le Draoulec.
"C'est plutôt l'inverse", explique même Maria Candea, linguiste de l'université Sorbonne nouvelle. En 2012, "les emplois de la langue avaient beaucoup bougé et la demande sociale de suppression de l'injonction d'affichage du statut marital pour les femmes - mais pas pour les hommes - était suffisamment forte pour qu'elle se traduise par une circulaire".
"Ce n'est pas l'écrit qui prescrit", abonde Véronique Perry, "la lanque appartient à la population, on est souverain par la langue". Mais changer les habitudes prend du temps, "la langue évolue plus lentement que la société", souligne la linguiste. Dans le cas de "mademoiselle", "une bonne partie de la population ne doit même pas avoir conscience de que ce mot peut signifier", explique également Anne Le Draoulec.
C'est la population qui décidera donc de l'avenir du terme. "Si des personnes veulent encore se faire appeler 'mademoiselle', c'est leur choix", déclare Véronique Perry, mais l'important est que celles qui refusent voient leur volonté respectée.








