Comment l'Eglise a choisi ses quatre évangiles
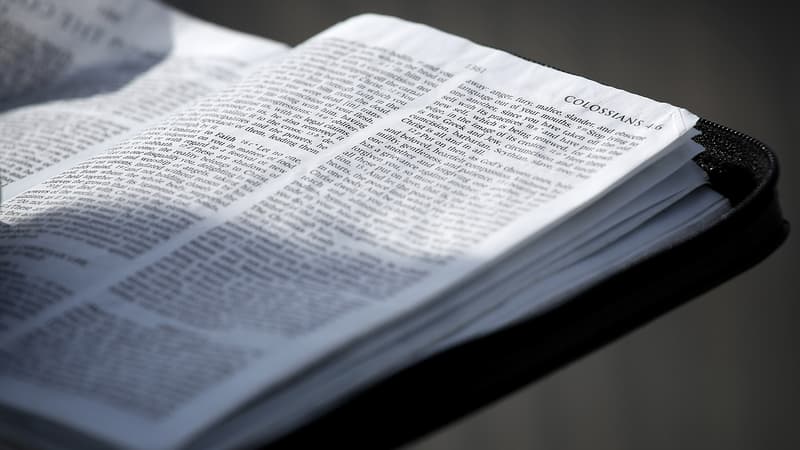
(Photo d'illustration) - WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Les fidèles se rendent ce mercredi, jour de l'Assomption, dans les églises pour célébrer l'élévation de Marie au Royaume de Dieu. Même s'il ne dit rien de ce dernier voyage de la Vierge, il faut bien sûr s'en remettre au Nouveau Testament, qui en dessine un portrait parfois impressionniste, pour approcher cette figure centrale du christianisme.
Trompeuse évidence
Il y a un an La Croix notait que 34 millions de bibles avaient été diffusées dans le monde en 2016, et que 360 millions de livres, en premier lieu le Nouveau Testament ou des volumes reprenant les seuls évangiles, tirés de cette matrice, s'étaient ajoutés à cette impressionnante cohorte. On a cessé depuis bien longtemps de chiffrer le nombre de traductions.
Après des siècles d'une si large diffusion, le Nouveau Testament a des airs d'évidence: d'un côté les quatre évangiles, ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean et les Actes des apôtres, à l'autre extrémité la saisissante et obscure Apocalypse, et entre ces deux pôles vingt épîtres, c'est-à-dire des lettres, dont treize attribuées à Saint Paul, et d'autres à Jacques, Pierre, Jude et Jean. Pourtant, considérer qu'un tel codex allait de soi, ou est aussi vieux que le christianisme, serait une erreur.
Pendant les premières décennies de leur religion, les chrétiens commentaient les textes de la bible hébraïque plutôt qu'ils n'écrivaient leurs propres récits de référence. Puis, progressivement, la tendance s'est inversée, voyant les fidèles du message de Jésus relater de nombreuses manières l'existence et les paroles du crucifié. Il a alors fallu que l'Eglise intervienne pour mettre de l'ordre dans cette profusion, et fixe un canon en même temps que les textes sur lesquels tous les croyants pouvaient s'appuyer. C'est au cours du IIe siècle que les choses se sont décantées.
Mais pourquoi l'Eglise a-t-elle consigné côte-à-côte quatre évangiles et non trois ou cinq? Pourquoi ceux-là? Et pourquoi a-t-elle écarté et plongé dans l'oubli le Diatessaron, la tentative de fondre en un seul les quatre évangiles unanimement reçus?
Le sens de l'intuition d'un hérétique
Curieusement, c'est à l'un des premiers hérétiques connus de l'histoire de l'Eglise que l'on doit le coup de pied à la fourmilière qui aboutira au corpus que l'on connaît aujourd'hui. On l'appelle Marcion, la tradition le dit venu du Pont, né de l'évêque de Sinope, à une époque où le célibat ne se pratiquait pas encore. On sait qu'il a débarqué à Rome en 140 et, homme riche, a fait un don généreux à l'Eglise... avant pourtant d'être écarté dès 144.
Il faut dire qu'il n'y est pas allé par quatre chemins. Marcion professait une doctrine selon laquelle il existe deux dieux: le premier a créé le monde, est raconté dans ce que l'on appellerait l'Ancien Testament, tandis que le second est annoncé par Jésus, et doit supplanter son prédécesseur. Car pour Marcion, il n'y a rien de commun entre le "dieu jaloux" de la Torah et le "dieu d'amour" de Jésus. Et il s'agit pour lui d'en tirer les conséquences: puisqu'on ne parle pas du même dieu, inutile de lire le même livre.
C'est par Marcion qu'est arrivée l'idée de prendre du champ par rapport à la Bible hébraïque et de façonner un ouvrage concurrent. Problème: Marcion pense que la plupart des apôtres et des évangélistes ont mal compris le message de Jésus. Seuls Paul, et son disciple Luc, sont selon lui restés dans la bonne voie. C'est pourquoi il ne valide en tout et pour tout que l'évangile de Luc et les lettres de Paul.
Et encore... "Il les a gardés mais expurgés des références à l'Ancien Testament", nous explique Dominique Cerbelaud, docteur en théologie catholique, auteur notamment de Ecouter Israël : Une relecture critique de la théologie chrétienne à la lumière du dialogue.
Un autre indice pointe vers l'importance cardinale de la démarche de Marcion: on lui prête souvent d'avoir inventé l'expression de "Nouveau Testament". "A strictement parler, l'idée de "Nouveau testament" était déjà chez Paul. Ou plutôt chez Paul, on parle de l'"ancienne Alliance" et de l'"Alliance nouvelle", explique Dominique Cerbelaud.
Daniel Marguerat, professeur honoraire à la faculté de théologie et de sciences des religions de l'université de Lausanne et auteur, entre autres, de L’historien de Dieu. Luc et les Actes des apôtres, livre également son analyse auprès de BFMTV.com: "Marcion a été le premier à avoir construit une polarité aussi forte entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Mais je ne pense pas que l'expression soit de lui".
Désavoué, mis à l'écart, son livre chrétien, réduit à la portion congrue, rejeté, Marcion a pourtant enclenché un vaste mouvement saisissant toute une Eglise, désormais en quête d'un ensemble fixe d'écritures saintes bien à elles. "Il a fallu faire pièce à son intuition selon laquelle il fallait construire sur un corpus scripturaire", reprend Daniel Marguerat.
Le grand tri
Un grand adversaire de Marcion va jouer un rôle primordial dans cette tâche: Irénée de Lyon. Originaire d'Asie mineure, et devenu évêque de Lyon, il est un des pères de l'Eglise. Soucieux de proposer un Nouveau Testament sur lequel tout le monde s'accorde, il redoute, au moment où il s'attelle à cette mission, vers 180, non pas le vide mais plutôt le trop-plein. "L'objectif premier, c'est de se trouver un dénominateur commun pour bâtir une orthodoxie, pas de se faire une bibliothèque", lance Daniel Marguerat.
En effet, qui veut alors réunir un Nouveau Testament ne doit pas écrire mais faire le tri. A la fin du IIe siècle, le christianisme est déjà plus riche en sensibilités, courants, disputes qu'il ne le sera par la suite.
"A son époque, il y avait pléthore d'évangiles. Une centaine, peut-être, circulaient. Les gnostiques, par exemple, en avaient écrit une quantité, dont l'Evangile selon Thomas. Il y avait aussi les évangiles judéo-chrétiens comme l'Evangile des Nazaréens ou celui des douze apôtres. Irénée prend le parti d'éliminer les uns et les autres", détaille Dominique Cerbelaud. "En quelque sorte, Irénée de Lyon est un centriste et il élimine les textes les plus extrémistes", sourit ce dernier.
A une ère où on est bien incapable de radiographier l'origine et la datation des documents, Irénée de Lyon enquête à sa manière. "Il a écrit aux Eglises qu'il connaissait. Il a demandé: 'Quels sont les Evangiles que vous avez depuis toujours?'", continue Dominique Cerbelaud. Les œuvres de Matthieu, Marc, Luc et Jean donc, sont ressortis. Disposait-il d'autres critères pour retenir un livre ou s'en détourner? "Quels ont été les critères, personne ne pourra vraiment vous le dire. Même si on a des hypothèses", répond Daniel Marguerat. Dominique Cerbelaud avance la sienne: "Il s'est fondé sur deux critères, l'ancienneté et l'unanimité".
Un évangile devait par conséquent remonter aux apôtres ou à leurs disciples et être catholique au sens premier du terme, c'est-à-dire largement répandu parmi les communautés chrétiennes.
Un argument étonnant
Ayant grandi en Orient, sur un bout de la côte turque léchée par la Mer Egée, mais exerçant ses fonctions en Gaule, sur les bords du Rhône, Irénée a sans doute dû faire parler son sens politique au moment de constituer le canon: "Récuser l'Evangile de Jean, ça aurait été se couper des Eglises d'orient, récuser celui de Marc serait revenu à se couper des communautés latines", pose Daniel Marguerat.
Si les raisons d'accepter ces quatre évangiles paraissent claires, le chiffre n'a rien d'évident. Pourtant, Irénée de Lyon a abordé ce point ouvertement dans son ouvrage Contre les hérésies. Force est de constater que l'argument est aussi alambiqué que daté.
"Il ne peut y avoir ni un plus grand ni un plus petit nombre d'Évangiles (que quatre). En effet, puisqu'il existe quatre régions du monde dans lequel nous sommes et quatre vents principaux, et puisque, d'autre part, l'Église est répandue sur toute la terre et qu'elle a pour colonne et pour soutien l'Évangile et l'Esprit de vie, il est naturel qu'elle ait quatre colonnes qui soufflent de toutes parts l'incorruptibilité et rendent la vie aux hommes. D'où il appert que le Verbe, Artisan de l'univers, qui siège sur les Chérubins et maintient toutes choses, lorsqu'il s'est manifesté aux hommes, nous a donné un Évangile à quadruple forme, encore que maintenu par un unique Esprit", écrivait l'évêque.
Un souci démocratique
"C'est de la spéculation", rembarre Daniel Marguerat. "Il a construit une symbolique sur quatre mais l'aurait faite sur trois s'il avait gardé trois textes". Dominique Cerbelaud s'intéresse davantage à la grande méfiance du penseur à l'idée d'un évangile unique. "Il dit aussi que les hérétiques ne gardent qu'un seul évangile. Les judéochrétiens ne connaissent que Matthieu, Marcion ne connaît que Luc, les gnostiques que Jean et il invente probablement une quatrième catégorie ne lisant que Marc", nous dit notre interlocuteur qui souligne qu'il y a "une vraie réticence face au texte unique".
"C'était le pressentiment théologique selon lequel l'unité ne se ferait pas sans diversité, même s'il fallait donner des bornes à celle-ci", décrypte Daniel Marguerat. Il y aurait donc un souci démocratique, pour utiliser un terme moderne, dans la coexistence de voix différentes, parfois dissonantes, voire contradictoires, au sein d'un même Nouveau Testament. "Irénée a fait le pari que ces textes très différents pouvaient tenir ensemble, malgré la grande difficulté de gérer cette diversité", approuve Dominique Cerbelaud.
Et c'est un choix qu'Irénée de Lyon fait en connaissance de cause. En effet, se diffuse au même moment, le Diatessaron ("A travers quatre" en grec) qui fond en un évangile unique les écrits de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce texte semble aujourd'hui bien méconnu même s'il a été vigueur dans les églises syriaques jusqu'au Ve siècle.
Deux ou trois choses que l'on sait du Diatessaron
Attribué au mystérieux Tatien le syrien, on ne sait en réalité de ce texte, probablement rédigé vers 170, que ce qu'en disent quelques fragments et Ephrem de Nisibe, un théologien du IVe siècle, dans ses commentaires. Si des chercheurs ont essayé de reconstituer le Diatessaron, "tout effort de recomposition est un peu artificiel", juge Dominique Cerbelaud qui ajoute qu'on ne sait même pas dans quel langue il a été écrit.
Ignorons-nous donc tout de ce que fut cet évangile unique? Pas tout à fait. "L'idée la plus répandue, c'est que l'auteur du Diatessaron a voulu faire œuvre de catéchisme et présenter l'évangile de façon simple à qui ne le connaissait pas", observe encore Dominique Cerbelaud.
Mais pourquoi, alors, cette solution d'une apparente facilité, résolvant variations et contradictions, n'a-t-elle pas pris en Europe, avant de sombrer dans l'oubli? "Pour la même raison qui a fait que Marcion a été exclu", éclaire Daniel Marguerat. "Car le texte procédait par exclusion. En l'occurrence, il excluait la diversité des évangiles".
Par conséquent, à la fin du IIe siècle, l'Eglise n'a pas fait que choisir les contours de son livre saint. Elle a opéré un choix risqué et original: s'en remettre à une pluralité de points de vue, parfois parcourus de dissonances, pour traverser les épreuves et le temps. 1.800 ans plus tard environ, on est en tout cas loin d'avoir fait le tour du sujet.








