Nouveaux mots, nouveaux usages, comment la pandémie a changé la langue française
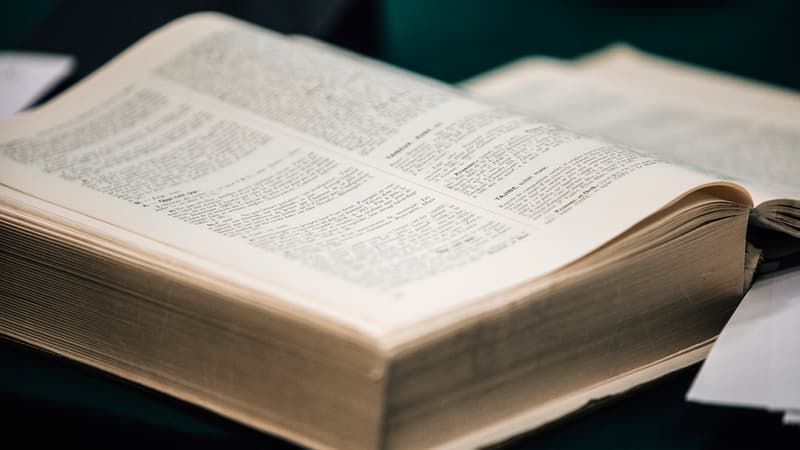
Un dictionnaire présenté à l'Académie française. (Photo d'illustration) - Académie française
Comorbidité, taux d'incidence, sérologique... Qui aurait cru, il y a deux ans de cela, que ces mots seraient employés lors de simples repas de famille? Ils sont pourtant devenus quotidiens. La pandémie a bouleversé notre manière de parler. Certains termes s'étant diffusés plus vite que le virus lui-même.
À quel point la pandémie a-t-elle changé notre langue? Selon Bernard Cerquiglini, linguiste et conseiller scientifique du Petit Larousse, interrogé au micro de BFMTV, au-delà de tous être devenus des apprentis médecins, nous sommes surtout devenus des "apprentis lexicographes et des apprentis grammairiens".
Skypéro et coronapistes
"La résistance à la pandémie s'est d'abord faite par la langue, car le collectif en France passe par la langue", explique le linguiste. Dans une période de confusion, mettre des mots sur ce que l'on ne connaît pas est primordial. Les mots du Covid disent ainsi beaucoup de nos maux.
"Nous avons créé des mots, changé le sens des mots et surtout, nous avons joué avec les mots", poursuit Bernard Cerquiglini. Ainsi, des termes peu courants sont venus sur le devant de la scène (pandémie, écouvillon...), des mots se sont transformés ('se masquer' qui ne veut plus dire 'se déguiser') et des mots ont même été créés de toute pièce (déconfiner, reconfiner...). Sont également nés des termes comme "skypéro" ou "coronapiste". Selon le linguiste, il s'agit d'une réaction ludique et saine pour la population.
Vitalité de la langue française
Au-delà de nous être nécessaires, ces évolutions sont également des bienfaits pour la langue elle-même. "La pandémie a prouvé la bonne santé de la langue française", se réjouit Bernard Cerquiglini. Elle en a, en effet, montré sa vitalité. On se souvient pourtant tous du bras de fer avec l'Académie française afin de prononcer "la" covid, au féminin. Se sont ainsi la règle (covid, la maladie) et l'usage (le coronavirus, devenu le covid) qui se sont affrontés.
D'ailleurs, des mots liés à la pandémie ont fait leur entrée dans l’édition 2022 du dictionnaire Le Petit Robert. C'est le cas de "geste barrière" ou de "téléconsultation". "Covid" lui-même apparaît dans la liste. Le dictionnaire tranche d'ailleurs la poire en deux en proposant de dire qu'il s'agit d'un nom féminin aussi bien que d'un nom masculin.
Anglicismes
Depuis le printemps 2020, les mots de la pandémie ont eux-mêmes évolué. Si de nombreux anglicismes ont été utilisés, pandémie mondiale oblige, la langue s'est elle-même corrigée au fil du temps, à l'instar de "cluster" ou "tracking", très vite remplacés par "foyer de contamination" et "traçage". De la même manière, nous ne parlons désormais plus de "distanciation sociale", traduite de l'anglais "social distancing", mais de "distanciation physique".
Bernard Cerquiglini note également que, malgré les critiques fréquentes, la France utilise peu d'anglicismes comparée à nombre de ses voisins. "Par exemple, en Italie, on ne dit pas 'confinamento' pour parler de confinement, mais 'lockdown", qui est le terme anglais".








