Ciseaux génétiques: une révolution médicale aussi exaltante qu'inquiétante
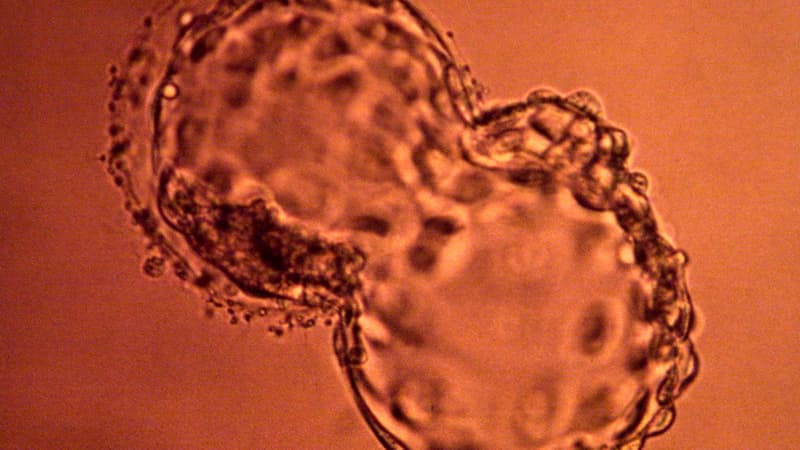
Un embryon humain (photo d'illustration) - Marcel Mochet-AFP
Bientôt la fin des maladies génétiques? C'est peut-être le début d'une révolution. Des ciseaux génétiques permettent dorénavant de corriger ou modifier l'ADN. La technologie Crispr-Cas9, prononcer "crispeur casse neuf", a été mise au point en 2012 et ouvre un horizon d'espoir dans le traitement des maladies génétiques graves. Mais elle soulève aussi des questions éthiques, qui seront débattues lors des États généraux de la bioéthique qui ont été lancés ce jeudi.
Comme l'a en effet évoqué le Comité consultatif national d'éthique dans son dossier de présentation des États généraux, "la modification du génome, à partir de nouvelles techniques de 'ciseaux génétiques', est désormais possible et se pose aujourd'hui la question de l'attitude éthique à adopter vis-à-vis des nouvelles possibilités d'ingénierie du vivant qui s'offrent à l'humanité, notamment au regard de la possibilité de modifier le génome des cellules reproductrices".
"Ce qui semblait hors d'atteinte est envisageable"
Cette technologie simple et peu coûteuse permet d'identifier une séquence de l'ADN, de la couper et de la remplacer par une autre. Si la manipulation du génome de l'embryon n'est pas nouvelle, elle gagne cependant en précision. "Ce qui semblait hors d'atteinte est désormais envisageable", précise pour BFMTV.com Anne Cambon-Thomsen, directrice de recherche émérite au CNRS et chercheuse pour l'Inserm à l'Université Toulouse III.
Crispr-Cas9, ces "ciseaux moléculaires", représente "une amélioration technologique énorme en matière de qualité, de rapidité et d'efficacité par rapport à toutes les autres technologies existantes", assure Mylène Weill, directrice de recherche au CNRS spécialisée en génétique moléculaire, interrogée par BFMTV.com.
Il est ainsi possible, en théorie, d'inactiver un gène défectueux ou de le corriger, voire d'augmenter son expression. En août dernier, une équipe internationale de chercheurs a réussi à modifier des gènes porteurs d'une maladie cardiaque héréditaire dans des embryons humains, sans toutefois les laisser se développer.
Une transplantation d'organes du porc
Les applications pourraient être nombreuses sur le vivant, comme modifier les caractéristiques d'animaux d'élevage ou rendre des plantes plus résistantes. "On pourrait également envisager de traiter certains cancers ou tuer des bactéries résistantes aux antibiotiques", remarque pour BFMTV.com Christine Pourcel, chercheuse à l'institut de biologie intégrative de la cellule à l'Université Paris-Saclay. Des applications plus étonnantes sont aussi imaginées.
"Une équipe est actuellement en train de travailler sur des porcs modifiés afin de permettre une transplantation d'organes à l'homme. C'est l'animal le plus proche physiologiquement de l'être humain. Un problème restait à résoudre: supprimer un virus présent dans les chromosomes porcins. Crispr-Cas9 va pouvoir les rendre compatibles à l'homme."
Crispr Therapeutics, fondée par la généticienne française Emmanuelle Charpentier à l'origine de la découverte avec l'Américaine Jennifer Doudna, a annoncé les premiers essais chez l'homme adulte pour 2018 dans le cas de deux maladies génétiques du sang, rapportait Le Figaro. La société fondée par Jennifer Doudna a quant à elle annoncé un essai clinique pour une maladie de l'œil.
Des mutations génétiques inattendues
Mais cette technologie n'est pas encore parfaite. "Les spécialistes disent qu'il faudra encore plusieurs années pour la maîtriser", indique Mylène Weill, qui dénonce un certain emballement. Il se pourrait que la modification du génome provoque en effet une réaction en chaîne de changements dans l'ADN.
Au printemps 2017, une étude de l'université Columbia, aux États-Unis, a remarqué que ce découpage génétique entraînait de nombreuses réactions inattendues. Si les chercheurs ont pu corriger un gène de la cécité chez la souris, ils ont constaté que les animaux, en apparence sains, avaient pourtant développé plusieurs centaines de mutations, délétions et insertions nouvelles.
Sans compter que, selon Christine Pourcel, le mystère génétique n'est pas encore élucidé. "On ne connaît pas tous les rôles de chacun de nos gènes. En modifiant une fonction, il n'est pas certain qu'il n'y ait pas d'effets inattendus sur d'autres organes. Par exemple, en modifiant le muscle, cela ne va pas gonfler que nos biceps. Il y a des muscles partout dans notre corps, il n'est pas impossible qu'il y ait des conséquences qu'on n'avait pas imaginées."
Des expériences ont cependant été menées par certains laboratoires pour modifier le génome de plantes ou d'animaux grâce à la technologie Crispr-Cas9. Les scientifiques ont ainsi donné vie à des champignons qui ne brunissent pas, des rats avec une meilleure vue, des vaches sans corne ou encore des chiens avec une masse musculaire plus importante.
La question de la transmission à la descendance
Pour l'instant, pas question de faire de même sur l'embryon humain. Du moins dans l'Hexagone et dans 28 des 47 pays membres du conseil de l'Europe, comme le rappelait La Croix. Il est en effet interdit, par la convention d'Oviedo ratifiée par la France en 2011, de pratiquer toute modification du génome qui puisse être transmissible. Donc de faire naître une personne dont l'ADN aurait été modifié.
"C'est la ligne rouge, remarque Anne Cambon-Thomsen. Lorsque l'on touche l'embryon, cela se répercute sur toutes les cellules, y compris les cellules sexuelles, les gamètes, ce qui rend la mutation transmissible à la descendance. On ne sait pas ce que cela donnera pour les générations suivantes. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir si nous avons le droit de modifier le génome de façon transmissible."
"La technologie va plus vite que la réflexion éthique"
L'une des applications du Crispr-Cas9 soulève une autre question éthique. Ce que l'on appelle le forçage génétique permet de transmettre un gène à toutes les générations d'une même population par la reproduction.
"Cela pourrait s'appliquer dans la lutte contre ce qu'on désigne comme les toxiques, qu'il s'agisse de plantes ou d'insectes, pointe Mylène Weill, spécialiste de l'adaptation des moustiques. Cela donnerait, sur le papier, la possibilité d'éradiquer une espèce. Mais qui sommes-nous pour décider de cela? Quelle place occupe cette espèce dans la nature?"
La scientifique adresse une mise en garde et craint que ce type de modification génétique ne se transmette dans la nature à d'autres espèces.








