Election: que risque-t-on à faire des selfies dans l'isoloir?
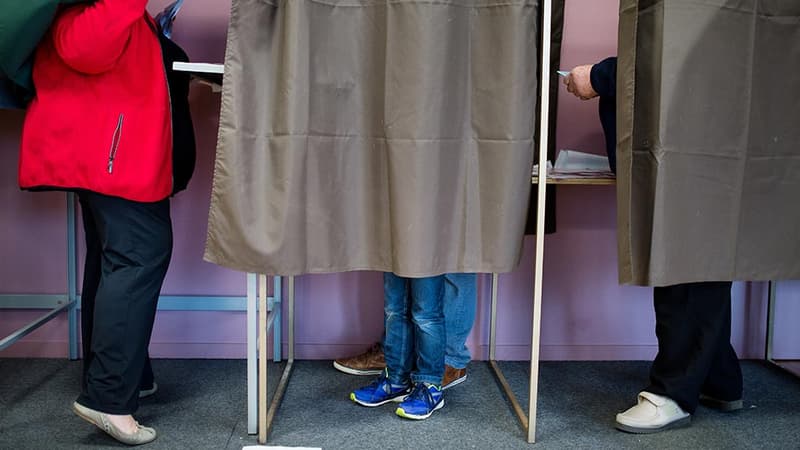
Un isoloir lors d'une élection (photo d'illustration). - Jean-Sébastien Evrard - AFP
Selfie, story Snapchat ou Instagram... certains seront sans doute tentés dimanche, de documenter leur vote et d'immortaliser l'instant dans l’isoloir pour le diffuser sur les réseaux sociaux. Cette question des selfies dans l’isoloir se pose désormais à chaque élection.
On devrait d’ailleurs voir ressurgir sur Twitter dimanche le hashtag “selfisoloir” lancé en 2014 à l'occasion d'élections municipales. A la veille du premier tour de l'élection présidentielle, sachez ce que vous avez le droit de faire, ou non, planqué derrière le rideau de l’isoloir.
Le selfie est-il interdit?
La question s’est posée au moment des élections municipales en 2014. C’est d’ailleurs à ce moment-là que le ministère de l’Intérieur a communiqué sur le sujet, indiquant qu’il valait mieux éviter. Sachez donc que prendre des selfies dans l'isoloir est fortement déconseillé, mais que rien ne vous l’interdit.
Le code électoral ne prévoit rien en la matière, si ce n’est pas que “le scrutin est secret”. L'article L-62 du code électoral précise ainsi que l'électeur "doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe".
Mais comme le précise Benoît Camguilhem, docteur en droit et maître de conférence en droit public, "si le scrutin est secret, le vote, lui ne l'est pas. Vous avez parfaitement le droit de dire pour qui vous votez. Le problème du selfie dans l'isoloir c'est qu'on est entre les deux".
Il ajoute que le selfie remet plutôt en cause "la solennité du vote". "On se situe sur un aspect moral et civique plus que proprement juridique. Pour l’instant il n’y a pas d’interdiction formelle et je ne vois pas comment elle pourrait exister et être respectée".
Pourquoi c’est déconseillé
L'utilisation du selfie ou de la story Snapchat ou Instagram dans l’isoloir soulève deux problèmes. Le premier risque est celui des éventuelles pressions. On peut en effet imaginer utiliser le selfie comme preuve qu'on a bien voté pour tel ou tel candidat, à la demande d'une tierce personne.
"Le simple fait de le faire et a fortiori de le publier peut générer un soupçon sur l'indépendance de l'électeur quant à son vote. En effet, rien ne peut garantir que cette publication n'ait été exigée, notamment par des pressions", précisait ainsi le ministère de l'Intérieur en 2014, interrogé par le Figaro.
Le second risque provient de la diffusion sur les réseaux sociaux. "On entre dans le problème qui est celui de faire de la propagande électorale un jour d’élection, ce qui est interdit", rappelle Benoît Camguilhem. Mais en la matière, la justice a tranché. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté dans un jugement de 2014 le recours d’un candidat contre des selfies pris par les filles de son adversaire dans l’isoloir.
Roger Cuche, le candidat malheureux aux municipales d'une petite commune de Moselle avait demandé l'annulation de l'élection, jugeant que les selfies d'isoloir postés par les filles de son adversaire avaient pu toucher des électeurs. Suivant les conclusions du rapporteur public, le tribunal a estimé que la pratique était certes “blâmable”, mais qu’elle n’avait pas eu “d’écho négatif sur la population”.
Il est en effet "impossible à établir si la diffusion d'un selfie a eu une influence sur le résultat du scrutin", note Benoît Camguilhem.
Qu’est-ce qu'on risque?
Essentiellement de se faire sortir par le président du bureau de vote. En vertu de l'article R49 du code électoral, "Le président du bureau a seul la police de l'assemblée", c'est à dire qu'il a le pouvoir d'expulser quiconque constitue une menace à l'ordre public et l'ordre moral.
"S'il estime pour une raison ou une autre qu'il y a un risque, cela peut rentrer dans son pouvoir de police", explique Benoît Camguilhem qui relève cependant que "a priori les risque de troubles sont plus forts s'il demande à quelqu'un de poser son téléphone que s'il ne le demande pas. Dans l'absolu ce n'est pas impossible, mais il faudrait qu'il ait de très bonnes raisons".








