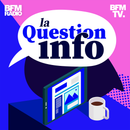Michaël Mitz
Progrès scientifiques, technologie… Des tueurs en série peuvent-ils encore sévir en France et "passer entre les mailles du filet"?
Paris, 26 mars 1998. La longue traque de l'homme qui semait la peur dans les rues endormies de la capitale s'achève à proximité d'une bouche de métro. Guy Georges est interpellé. Connu comme le tueur de l'Est parisien, il est soupçonné d'avoir violé puis tué sept jeunes femmes entre 1991 et 1997. Le tueur en série a pu agir pendant près de sept ans avant que les enquêteurs ne parviennent enfin à l'identifier, grâce à ses empreintes génétiques.
"Si on avait eu un fichier automatisé des empreintes génétiques, il aurait été identifié dès 1995", affirme Gilbert Thiel à BFMTV.com. "Deux femmes seraient encore de ce monde et leur famille n'aurait pas été détruite", appuie cet ancien juge d'instruction qui a instruit l'affaire.
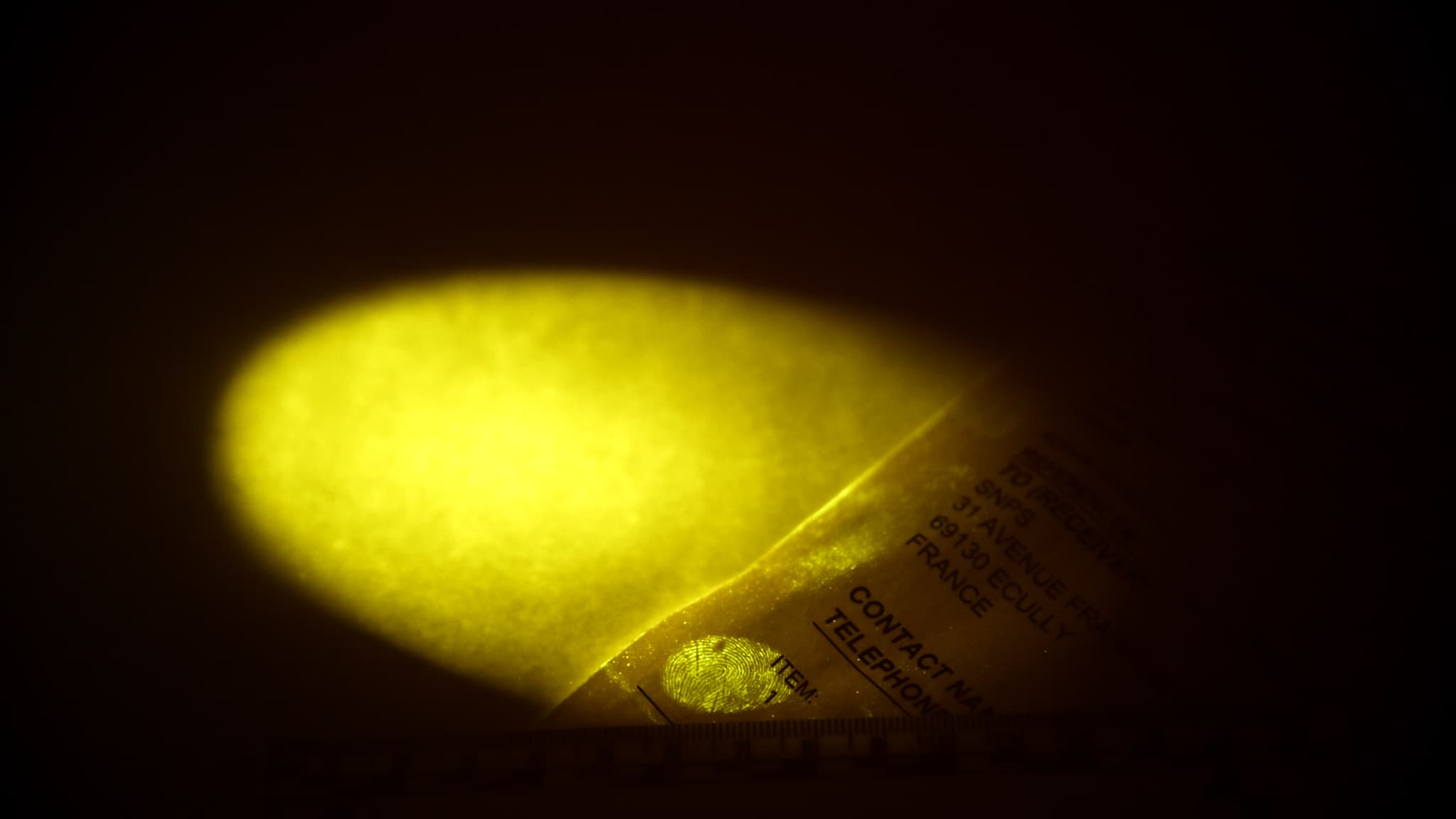
Des tueurs d'une autre époque?
Guy Georges, Francis Heaulme, Michel Fourniret, Émile Louis… Les tueurs en série fascinent autant qu'ils terrorisent. En France, il n'en existe aucune définition, mais une approche policière: un tueur en série tue au moins trois fois avec une intervalle de temps entre ses crimes.
Mais à l'heure des nouvelles technologies et du progrès dans le domaine de la police scientifique, les tueurs peuvent-ils encore commettre des séries de meurtres sans être identifiés et interpellés?
"Avec l'évolution des techniques, il est de plus en plus difficile pour un tueur en série de passer entre les mailles du filet", estime Gilbert Thiel. L'ancien juge d'instruction a connu la France des années 80. Une France où "il y avait une vingtaine de fichiers des empreintes digitales qui n'étaient pas reliés entre eux", détaille l'auteur de l'ouvrage Tueurs en série made in France paru aux éditions Robert Laffont. Cette désorganisation a par exemple retardé l'identification de Thierry Paulin. Ce jeune homme, plus connu sous le nom du tueur de vieilles dames, a assassiné 18 femmes âgées entre 1984 et 1987 à Paris.
Si les policiers parisiens sont parvenus à prélever ses empreintes digitales sur plusieurs scènes de crimes, elles n'apparaissaient pas dans leur fichier. Pourtant, au début des années 80, les traces de doigts du tueur en série avaient bel et bien été identifiées après l'attaque d'une épicerie de la région toulousaine. "Il était fiché là-bas, mais l'ensemble de ses crimes étaient perpétrés à Paris donc ça n'est jamais remonté", détaille Gilbert Thiel.
L'affaire Thierry Paulin contribuera à la création du fichier automatisé des empreintes digitales (Faed). De l'affaire Guy Georges, la France tire également des enseignements en créant le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg) en 1998. Il compte aujourd’hui un peu plus de 4 millions d'ADN.
L'ADN: un outil clé et encore des progrès
"Depuis les années 2000, l'avènement de l'ADN a bouleversé les enquêtes", explique Sébastien Aguilar, policier scientifique et membre du Syndicat indépendant des agents du ministère de l'Intérieur (SNIPAT). Daniel Soucaze ne peut que le confirmer. "Si Laure Martinet avait été tuée en 2025, Patrice Alègre aurait été immédiatement identifié", affirme l'ancien enquêteur de la section de recherches de Toulouse auteur du livre Autopsie de l'assassin, paru chez Mareuil Editions.
Patrice Alègre a fait trembler Toulouse et sa région entre 1989 et 1997. Laure Martinet est l'une de ses cinq victimes. Le jour de sa mort, la jeune étudiante de 19 ans, deuxième de la longue série noire d'Alègre, avait d'abord été violée par le tueur en série et de l'ADN avait été retrouvé sur son corps.
Pour savoir d'un suspect s'il est tueur en série encore faut-il qu'il soit identifié grâce aux éléments de l'enquête ou son ADN. Or, il arrive qu'un ADN n'apparaisse pas au Fnaeg.

Mais là encore, les progrès techniques croissants offrent un panel de possibilités aux enquêteurs. Ils peuvent par exemple remonter jusqu'à un potentiel tueur en série grâce à l'ADN de parentèle. Cette technique permet de remonter aux membres d'une même famille à partir d'une empreinte génétique inscrite au Fnaeg.
D'un ADN, il est également possible de tirer un portrait-robot génétique - couleur des yeux ou des cheveux, présence de fossette - depuis une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation de juin 2014.
"On pourrait même aller plus loin, c'est-à-dire demander si la personne est porteuse d'une maladie génétique ou d'une maladie chronique. Ça induit qu'elle est nécessairement rare. Et si ce traitement est rare, on peut contacter toutes les pharmacies qui délivrent un tel traitement", expose François Daoust, ancien directeur de l'IRCGN et du pôle judiciaire de la gendarmerie.
L'ADN reste toutefois faillible. "Il faut faire preuve d'une grande prudence. S'il a incontestablement bouleversé les enquêtes criminelles, il est loin d’être cette 'reine des preuves' que l’on a voulu ériger au début des années 2000", expose Sébastien Aguilar.
Encore faut-il que cette trace biologique soit véritablement pertinente. "C'est-à-dire étroitement liée à l'infraction et que les résultats génétiques soient correctement interprétés", poursuit le policier scientifique. Ces traces ADN peuvent en effet parfois être dégradées ou mélangées. D'où la nécessité "de coupler les investigations de police scientifique à une enquête de police très bien menée".
Téléphonie, vidéosurveillance et numérique
La France connaît depuis une vingtaine d'années l'essor du numérique, de la vidéosurveillance et de la téléphonie. "Ce qui a vraiment révolutionné les enquêtes et la police scientifique, c'est l'exploitation des données numériques que l'on retrouve la plupart du temps dans les téléphones, les ordinateurs, les objets connectés ou encore dans certains véhicules", appuie Sébastien Aguilar.
"On peut ainsi connaître potentiellement vos trajets, savoir éventuellement à quelle heure vous vous êtes déplacés, si vous avez eu un accident, ou à quelle vitesse vous rouliez ou si vous avez freiné ou non."
Des informations parfois précieuses dans des affaires criminelles. Dans les rues, les caméras de vidéosurveillance peuvent également fournir des éléments capitaux à l'enquête. Du temps de Guy Georges, "au milieu des années 90 à Paris, il n'y avait pas encore beaucoup de caméras de vidéosurveillance", relève Gilbert Thiel. "Maintenant, avec un réseau plus dense, on peut aller rechercher dans les rues adjacentes, à l'heure présumée du crime, regarder un peu ce qu'il s'est passé", souligne-t-il. Les caméras dans la rue, les caméras privées, les téléphones et les objets connectés "peuvent trahir l’auteur et donc l’empêcher d’agir", expose de son côté Jacques Dallest.
Cette évolution constante des techniques d'investigation fait penser à Sébastien Aguilar, policier scientifique et membre du Syndicat indépendant des agents du ministère de l'Intérieur (SNIPAT), qu'il est "peu probable" qu'un tueur en série du même acabit d'un Fourniret, Guy Georges ou Francis Heaulme soit dans la nature en 2025.
"Avec les nouvelles technologies et les techniques d’enquête toujours plus performantes, les chances pour un tueur en série d’agir longtemps sans être repéré diminuent considérablement" ajoute-t-il, en citant les géoradars, les drones, mais aussi l'essor de l'intelligence artificielle.
"Couplée à des drones ou à des géoradars, l’IA peut aujourd’hui analyser en temps réel de vastes zones, détecter des anomalies dans le sol, comme une terre récemment retournée, ou repérer la présence possible d’un objet ou même d’un corps." Ce type d'outils offre un "gain de temps considérable dans les recherches, notamment lorsqu’il faut couvrir plusieurs hectares rapidement".
Parfois, un simple défaut de permis de conduire ou une conduite alcoolisée suffisent. "On va prendre leur empreintes et les ADN et à ce moment-là vous allez avoir match sur une affaire criminelle", expose Sébastien Aguilar. L'affaire du Grêlé est aussi un bon exemple. François Vérone, un ancien gendarme qui se cachait derrière cinq meurtres entre 1986 et 1994, a été identifié grâce à l'examen de son ADN prélevé après son suicide en 2021.
Quand les corps donnent des indices
Dans les affaires criminelles, l’autopsie d'un corps joue, elle aussi, un rôle essentiel. Elle permet de mieux comprendre à la fois les causes, mais aussi les circonstances de la mort.
"Dans certains cas, le médecin légiste peut identifier une forme de répétition, une 'sérialité', à travers le mode opératoire de l’agresseur, la nature des blessures ou l’arme utilisée", détaille Sébastien Aguilar.
"Par exemple, certains tueurs en série laissent derrière eux une signature bien reconnaissable: une mise en scène particulière du corps, un type de lésions spécifiques. Ces éléments récurrents peuvent ainsi permettre aux enquêteurs d’établir un lien entre plusieurs affaires a priori isolées."
Ces liens, les enquêteurs les recherchent dès la commission d'un crime. "Des groupes d’enquêteurs travaillent chacun sur une hypothèse et remettent en commun chaque semaine ce qu’ils ont collecté et tout ce qui est revenu comme renseignements nationaux un peu partout en France", explique François Daoust. "Un groupe travaille sur l'hypothèse d'une pluralité d'auteurs dans des affaires, un autre sur l'hypothèse d'un même auteur."
Les rapprochements entre les différentes affaires, s'ils existent, sont donc réalisés a posteriori. Le pôle cold cases de Nanterre se charge notamment d'établir ces liens pour résoudre des affaires non-élucidées.
Encore faut-il qu'il y ait un corps. "Les criminels, comme toutes personnes, vont sur internet, ils se documentent", souligne l'ancien magistrat Jacques Dallest, notamment pour savoir comment faire disparaître un corps. "La plupart des criminels sériels agissent pour des raisons sexuelles, ils laissent donc des traces de leur ADN et ça, ils le savent" insiste Jacques Dallest.

Pour faire disparaître ces preuves, il faut faire disparaître le corps. "Et s'ils sont parvenus à le faire, ils sont dans l'impunité puisque ce sera difficile de remonter jusqu'à eux, à moins qu'en agissant à plusieurs reprises, ils laissent des traces derrière eux."
"On n'empêchera jamais des tueurs en série d'exister"
Si les nouvelles techniques et technologie aident à l'identification d'un criminel, "ce serait une illusion de croire que toutes les techniques qui existent empêcheront l'émergence et surtout la réalisation d'une série aussi petite soit-elle", estime François Daoust.
Selon l'ancien directeur de l'IRCGN et du pôle judiciaire de la gendarmerie, grâce aux techniques modernes, couplées aux témoignages recueillis sur le terrain, les enquêteurs "pourront arriver, peut-être, parfois, à coincer une personne après le premier acte, après le deuxième acte ou au moment du troisième". Mais, "on n'empêchera jamais des tueurs en série d'exister, de passer à l'acte, et de continuer leur série".
"En matière de viol en série, on sait qu'il y a encore des personnes qui agissent parce qu'on a des ADN communs dans les dossiers qui ne sont pas encore élucidés", expose de son côté Me Marine Allali, avocate pénaliste, directrice au pôle aide aux victimes au cabinet Seban. "Pourquoi je parle du viol? Parce que bien souvent, dans tous les tueurs en série que l'on connaît aujourd'hui, il y a eu du viol avant, pendant et après."
Jacques Dallest estime de son côté qu'avec les progrès de la science, "on peut mettre hors d'état de nuire un criminel dont on peut penser qu'il aurait tué d'autres personnes", citant le cas Nordahl Lelandais. "Je pense que s'il n'avait pas été arrêté, il en aurait tué d'autres", poursuit-il. "Grâce à ce travail-là, on peut prévenir la répétition, ce qu'on ne pouvait pas faire dans le passé."
Des tueurs en série derrière des meurtres irrésolus?
Jacques Dallest pointe par ailleurs une faille dans le système judiciaire qui peut profiter aux tueurs en série: l'absence de mémoire criminelle dans les parquets. "On ne sait pas trop ce qu'il s'est passé avant notre arrivée, sauf si les dossiers sont en cours d'instruction." Un avis que partage Me Marine Allali. "On oublie les meurtres irrésolus parce qu'il y a un changement de parquet ou de juge d'instruction. Donc, si une personne tue une fois tous les dix ans, mais à des endroits en plus différents, les liens peuvent parfaitement ne jamais être faits."
La criminalité transfrontalière peut aussi complexifier l'identification d'un tueur en série. "Il suffit qu'une personne se déplace pour que ce soit problématique de relier une série", explique Me Marine Allali.
Jacques Dallest, lui, s'interroge quant aux disparitions inquiétantes. "Parmi ces personnes, certaines ont disparu volontairement, d'autres se sont suicidées ou sont mortes accidentellement, mais on peut penser que parmi elles, certaines ont malheureusement été victimes de mauvaises rencontres", expose Jacques Dallest. "On est dans un trou noir faute de corps."
Les tueurs en série peuvent-ils se cacher derrière des meurtres irrésolus? "Ce qui fait un tueur en série, c'est de rester dans l'impunité. C'est pour ça que c'est grave de ne pas élucider un meurtre", affirme Me Marine Allali.
Selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, 69% des homicides ont été élucidés au bout d'un an en 2022 soit une baisse de 12 points en cinq ans. "Vous imaginez le nombre de tueurs en série qui peuvent se cacher derrière ce chiffre..."