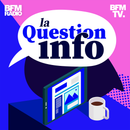Privée de la réintroduction de l'acétamipride, que contient la loi agricole Duplomb promulguée par Emmanuel Macron?

Allégée de l'acétamipride, la loi Duplomb achève son parcours législatif chahuté dans le sillage d'une mobilisation syndicale, d'une pétition de protestation qui a dépassé deux millions de signatures et d'une censure partielle par le Conseil constitutionnel. Dernière brique des promesses faites aux syndicats agricoles majoritaires au moment des mobilisations hivernales, la loi agricole –qui porte le nom du sénateur Laurent Duplomb (LR), auteur de la proposition de loi initiale– a viré au feuilleton politique.
Sa mesure la plus sensible, et qui a occupé l'espace médiatique, a sans nul doute été la réintroduction d'un pesticide de la famille des néonicotinoïdes, l'acétamipride. Ce dernier est interdit en France depuis 2018, mais reste encore autorisé ailleurs en Europe. Les producteurs de betteraves et de noisettes réclamaient son retour pour lutter contre certains ravageurs. Adoptée par les parlementaires, la mesure a toutefois été censurée par le Conseil constitutionnel, l'estimant insuffisamment encadrée.
Stockage de l'eau, rôle de l'Anses, construction de bâtiments d'élevage… Au-delà de la censure du retour de l'acétamipride, le Conseil constitutionnel a toutefois validé d'autres dispositions clefs portées par la loi Duplomb, avec quelques ajustements.
• Bâtiments d'élevage
L'un des articles facilite la création de bâtiments d'élevage intensif. Cet article permet, entre autres, d'alléger les procédures de consultation publique lors de la construction ou l'agrandissement de nouveaux bâtiments en remplaçant la réunion publique par une permanence en mairie lors de l'enquête publique.
Par ailleurs, le texte relève les seuils (c'est-à-dire le nombre d'animaux) à partir desquels les éleveurs doivent obtenir une autorisation environnementale. Ces seuils étaient jusqu'à présent aligné sur la directive européenne relative aux émissions industrielles, mais ils seront alignés sur une autre directive, plus permissive, à partir de la fin de l'année 2026. Par exemple, un poulailler ne devra demander une autorisation qu'à partir de 85.000 poulets, contre 40.000 poulets aujourd'hui.
• Rôle de l'Anses et de l'OFB
Le texte redessine également le rôle de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), mandatée depuis 2015 pour évaluer la dangerosité des pesticides et autoriser leur mise sur le marché. L'Anses doit désormais tenir compte "des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques qui prévalent sur le territoire national" lorsqu'elle examine la mise sur le marché et l'utilisation des pesticides.
Par ailleurs, un autre article s'attelle à apaiser les relations entre l'Office français de la biodiversité (OFB), chargé de la police de l'environnement, et certains agriculteurs. Les agents de l'OFB seront équipés de "caméras individuelles" et pourront procéder à "un enregistrement audiovisuel de leurs interventions" sur le modèle de la police et de la gendarmerie. La position du préfet, délégué territorial de l'OFB, est aussi renforcée.
• Stockage de l'eau
Le stockage de l'eau pour l'irrigation des cultures a été l'une des mesures sensibles de la loi Duplomb, dans un contexte de raréfaction lié au changement climatique et de débats autour des "méga-bassines". L'un des articles précise que les retenues de stockage d'eau à vocation agricole, constituées en puisant dans la nappe phréatique ou les cours d'eau, sont désormais présumées être "d'intérêt général majeur", afin de faciliter les procédures pour obtenir des autorisations de construction.
Mais le Conseil constitutionnel a émis deux réserves d'interprétation: les prélèvements sur les eaux souterraines excluent les nappes inertielles, c'est-à-dire les nappes phréatiques qui se vident ou se remplissent lentement, et les projets de construction seront contestables devant un juge malgré la présomption d'intérêt général majeur.