ÉDITO. Que faire du service national universel?
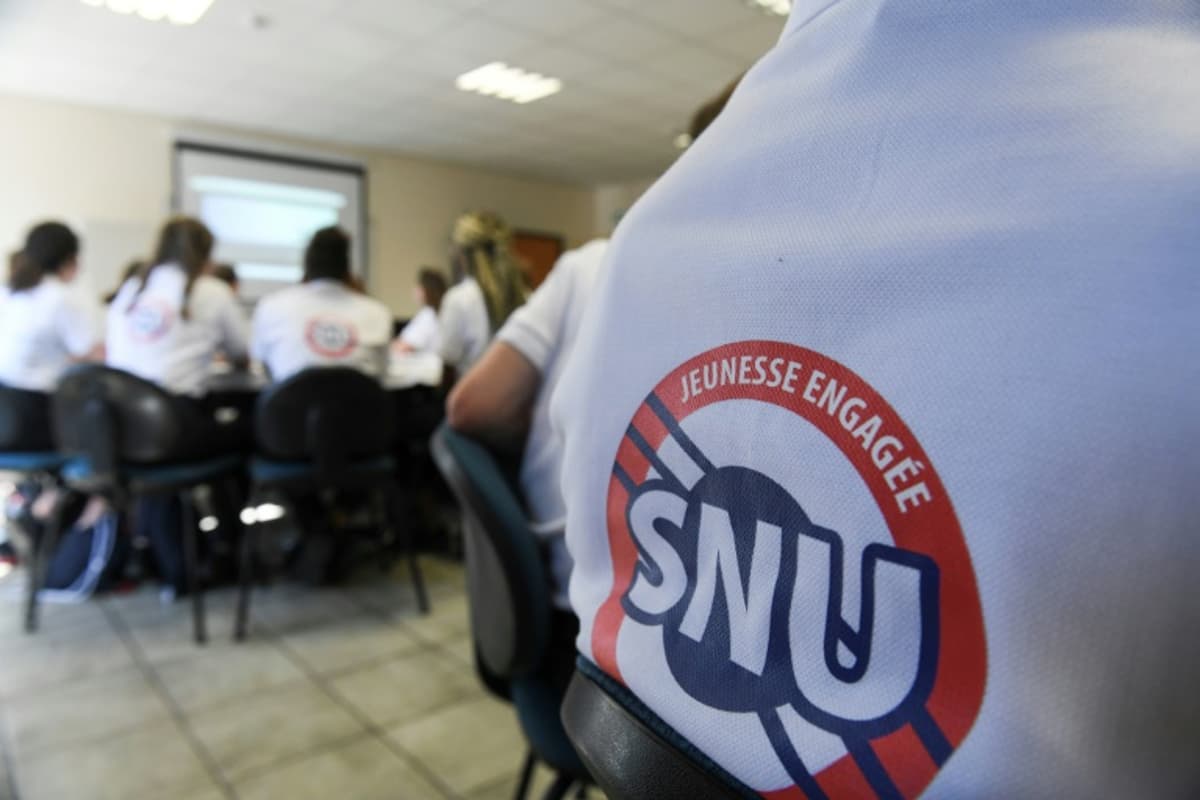
Après six années d'exercice, le bilan du service national universel (SNU) est assez mitigé. D'un côté le dispositif a bien grandi depuis son lancement en 2019. 57.000 jeunes entre 15 et 17 ans sont passés par le SNU l'année dernière. La plupart se déclarent plutôt satisfaits.
L'objectif est louable: il vise à renforcer la cohésion nationale, encourager l’engagement et favoriser la mixité sociale. Pour rappel, il se décline en trois phases : un séjour de cohésion de 12 jours, une mission d’intérêt général et un engagement volontaire dans une structure publique ou associative.
Mais de l'autre, les ambitions initiales sont loin d’être atteintes. Le SNU devait être généralisé en 2024, puis en 2026. Mais la dissolution de l'Assemblée nationale et les restrictions budgétaires semblent avoir sonné le glas de cette ambition. Il faut revoir le projet.
Qu’est-ce qui dysfonctionne?
D’abord les objectifs du SNU sont mal définis. Défense, engagement, insertion, valeurs républicaines… Tout y passe, mais rien n’est réellement priorisé. Les jeunes eux-mêmes ne savent pas toujours à quoi s’attendre, et l’image du programme oscille entre colonie de vacances et mini-service militaire.
Ensuite la mixité sociale est un échec. Les jeunes issus de milieux modestes, des quartiers prioritaires ou des filières professionnelles restent sous-représentés. Le SNU attire surtout des jeunes déjà engagés, venant de familles habituées à l’action associative ou ayant un lien avec l’armée ou les forces de l’ordre.
Autre point noir: l’organisation chaotique. Hébergement, transport, encadrement… Tout repose sur un équilibre fragile, avec des moyens humains insuffisants. Les encadrants sont trop peu formés et surchargés.
Enfin, et c’est crucial, le coût du SNU est largement sous-estimé. L’État annonce environ 2.300 euros par jeune, mais la Cour des comptes estime un coût réel de 2 900 euros, voire plus. Et si le programme devait être généralisé, on parle de 3,5 à 5 milliards d’euros par an. Dans un contexte budgétaire tendu, est-ce viable?
Que faudrait-il faire alors?
D’abord, il faut clarifier la mission du SNU. Vise-t-on un projet d’engagement citoyen? Un outil d’orientation pour la jeunesse? Un levier pour la résilience nationale? Il faut choisir et arrêter d’empiler des objectifs contradictoires.
Ensuite, renforcer la dimension locale. Pourquoi ne pas impliquer davantage les collectivités et les associations pour mieux toucher les jeunes éloignés du dispositif ?
Enfin, il est urgent d’assurer un vrai suivi budgétaire et de ne pas cacher les coûts réels. Si la généralisation est un objectif, il faut des structures d’accueil solides, une formation renforcée des encadrants, et une planification rigoureuse.
Le SNU est une belle idée, mais pour qu’elle tienne ses promesses, elle doit être repensée en profondeur. Sinon, elle risque de rester une ambition coûteuse et mal définie... Tellement français.
