TOUT COMPRENDRE - Les stocks stratégiques, atout du gouvernement face aux pénuries de carburant
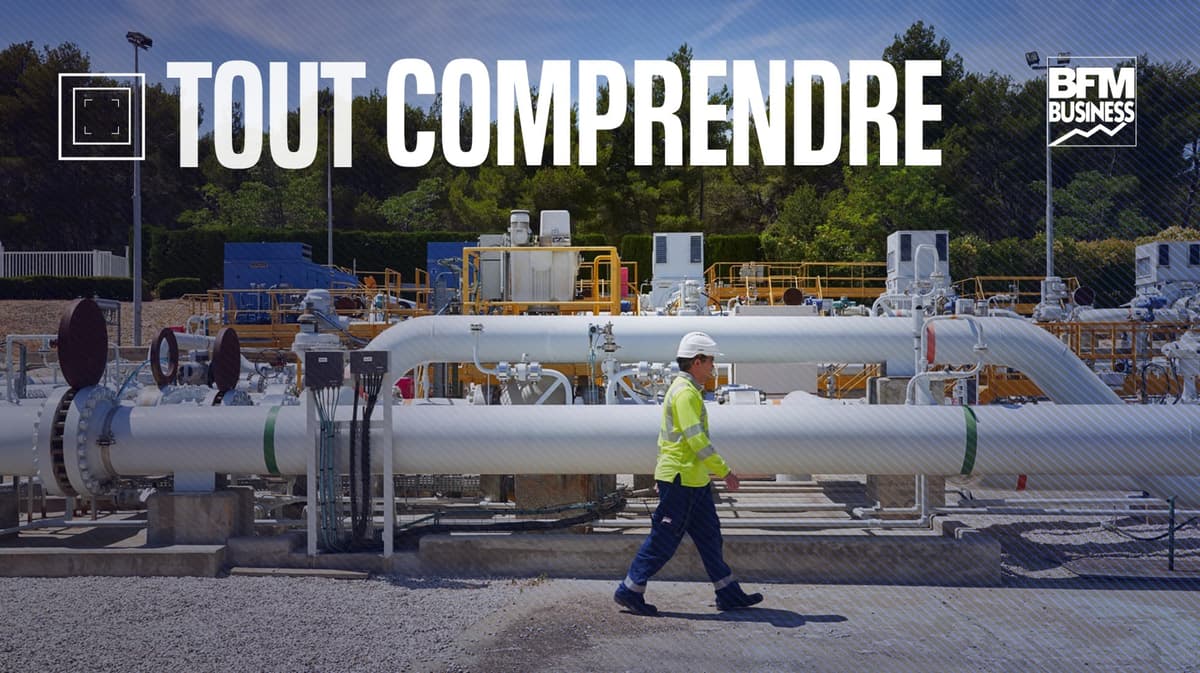
Ils sont au coeur de la réaction des pouvoirs publics face à la pénurie de carburants, aux côtés des réquisitions démarrées ce mercredi. Les vannes des stocks stratégiques ont été ouvertes ce week-end par le gouvernement, pour alimenter les stations-service et répondre en partie aux difficultés d'approvisionnement des consommateurs.
Selon des statistiques de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE), qui exige de ses membres 90 jours minimum d'importations nette de pétrole en stock, la France détient 115 jours de consommation dans ces cuves, pour répondre à des situations d'urgence.
• De quand date leur mise en place ?
La constitution de stocks a été progressive en France. Comme le rappelle cette note de la Revue de l'Energie, c'est en 1918 qu'apparait un Commissariat aux essences et combustibles, organisme public chargé de la gestion des flux. A la même date, les syndicats pétroliers forment un interlocuteur unique pour le gouvernement. Dans cette structure, l'entre-deux-guerres voit un décret s'imposer aux entreprises, tenues de "conserver à tout moment un stock de réserve représentant au moins "le quart des quantités déclarées pour la consommation au cours des douze mois précédent". La France monnaye l'accès à son marché à la constitution par les majors de stocks.
La Seconde Guerre mondiale marque la destruction des infrastructures, et la fin du conflit une hausse continue de la consommation. Conséquence, les stocks baissent et il faut attendre la crise de Suez, en 1956, pour qu'ils repartent à la hausse. Le canal de Suez est bloqué par Nasser, et les pays exportateurs (Libye, Arabie saoudite) ferment les vannes brusquement. La France est frappée de plein fouet et vit avec 15 jours de réserve à peine; en 1959, la notion de "stockage stratégique" est consacrée dans le Code de la Défense.
Après avoir longtemps été réticente à rejoindre une union de pays importateurs (craignant une hégémonie américaine dans le domaine), la France finit par rejoindre l'Agence Internationale de l'Energie en 1992. Elle s'aligne avec l'Union Européenne sur les standards fixés par l'agence minimum 90 jours de consommation stockés dans chaque pays membres.
• Ou se trouvent-ils ?
On recense 89 sites sur le territoire, d'origines diversifiées. Le détail des implantations n'est pas connu, pour des raisons stratégiques. 8 sites sont par exemple présents à proximité des raffineries, quand 80 autres sont situés sur des sites commerciaux par les entreprises pétrolières.
Le site le plus fourni - un tiers des 18 millions de tonnes stockés à ce jour - se trouve enfin à Manosque, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Il est en service depuis 1969 et est exploité par Geosel, une société spécialiste du stockage souterrain d'hydrocarbures. Sur place, 30 puits sont creusés dans des cavités salines, situées entre 600 et 1000 mètres de profondeur. Elles abritent 6 millions de mètres cubes de gazole, essence, ou pétrole brut. Ce site, le plus grand en Europe, est même relié directement à cinq pipelines et à une raffinerie.
• Qui en a la charge ?
La France a structuré la gouvernance de ces ressources clés après son entrée dans l'AIE, en 1993. S'est alors trouvée renforcée la Société anonyme de gestion de stocks de sécurité (SAGESS), chargée depuis 1988 de créer et conserver des stocks. Cette institution privée, mais non lucrative, a des actionnaires - issus de TotalEnergies, ENI, BP, Bolloré Energy, Shell ou encore Leclerc.
Elle permet aux entreprises, forcées à stocker par la loi, d'avoir une institution pour gérer administrativement et financièrement ces réserves, en achetant, vendant, et entretenant les sites. Cette SAGESS délégue ses stocks à un Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP), qui perçoit des cotisations des entreprises dépositaires, pour son fonctionnement économique. Ce comité regroupe des membres privés et publics, issus de plusieurs ministères.
Le contrôle de la localisation et de la quantité des ressources disponibles est enfin effectué par la direction des ressources énergétiques et minérales (DIREM), elle-même placée sous le giron de la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), qui appartient au ministère de la Transition écologique. Elle agit au côté des douanes.
• A quoi peuvent-ils servir ?
Les pouvoirs publics peuvent à loisir piocher dans ces réserves, à la faveur d'une situation considérée comme urgente. Ces stocks ne leur appartiennent donc pas mais demeurent dans la main du gouvernement.
Cela recoupe donc des situations faisant un planer un risque sur l'approvisionnement en énergie du pays - héritage de la crise de 1956 - mais aussi des risques plus politiques, comme la séquence actuelle de débrayages massifs parmi les travailleurs du secteur de l'énergie. Le précédent le plus marquant et le plus récent remonte à 2016, quand la gauche avait usé de ce stratagème pour casser une mobilisation, déjà - les syndicats protestaient alors contre le projet de loi Travail de Myriam El Khomri.
Les stocks peuvent aussi être débloqués sur décision de l'Agence Internationale de l'Energie, comme en début d'année. Après une première contribution de ses membres de 60 millions de barils début mars, l'institution avait tranché pour une deuxième salve du même acabit, sur une durée de six mois. Ces stocks devaient permettre de relâcher la tension mise sur les marchés par les sanctions prises à l'égard de la Russie, par les hausses de prix, et par les politiques restrictives de l'OPEP+.
