Sur internet, les femmes victimes d'un "retour de bâton" masculiniste
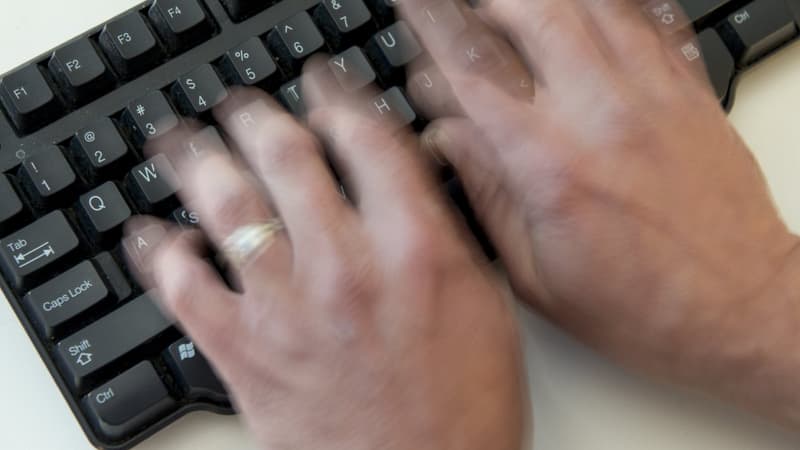
Les auteurs de raids masculinistes s’organisent sur des forums. - Saul Loeb - AFP
Le Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes (HCE) a publié son dernier rapport le 23 janvier. Au-delà du "constat alarmant", pour reprendre les mots de la note du HCE, il souligne que toutes les formes de harcèlement envers les femmes perdurent notamment en ce qui concerne le cyberharcèlement.
Le HCE dénonce le phénomène de backlash qui signifie "retour de bâton". Ce terme a été initié en 1991 par l’écrivaine américaine Susan Faludi et vise les discours antiféministes et réactionnaires qui ont vu le jour à la suite des mouvements et avancées féministes depuis les années 70. Ainsi, des réactions violentes émergent face au progrès des droits des femmes et donnent naissance à des termes comme "néo-féminisme", "wokisme", "féminazi"... Des réactions qui s'expriment aussi à travers les réseaux sociaux.
Toute une partie du rapport se penche sur le cyberharcèlement et affirme que "les ‘raids’ masculinistes se multiplient en ligne pour réduire les femmes au silence ou les discréditer".
Les auteurs de ces raids s’organisent sur des forums et cherchent par exemple à fermer des comptes qui les dérangent. Ils désignent alors des comptes à signaler en masse. "Cela fait maintenant plusieurs années qu’ils sont très bien organisés", constate auprès de Tech&Co Elvire Duvelles-Charles, auteure du livre Féminisme et réseaux sociaux, une histoire d’amour et de haine (éditions Hors d’atteinte) et créatrice du compte Instagram Clit Revolution.
Ciblées à cause de leur genre
Plusieurs études montrent en effet que ces actions perdurent. Amnesty International s’est notamment intéressé en 2018 aux personnalités publiques comme les femmes politiques ou journalistes. Sur un échantillon donné, une intelligence artificielle a relevé un million de tweets injurieux au cours d’une année, soit une publication haineuse toutes les trente secondes les visant.
En ligne, d’autres personnalités publiques comme les streameuses sont également la cible de ces insultes à l’image de Nat'Ali, streameuse jeux vidéo sur Twitch depuis bientôt six ans, qui subit un cyberharcèlement quotidien ou de Maghla, l'une des streameuses les plus suivies de France avec 700.000 abonnés sur Twitch. Le 24 octobre 2022, la vidéaste a publié une série de messages dans laquelle elle expose les contenus haineux qu’elle affronte quotidiennement sur internet. La streameuse Ultia a annoncé avoir porté plainte pour la vague de cyberharcèlement dont elle a été victime fin octobre.
Au-delà des personnalités publiques, de nombreuses femmes sont victimes de cyberharcèlement. Ainsi, une étude menée par le Pew Research Center en 2021 rapporte que 47% des femmes interrogées ont été victime de harcèlement en ligne à cause de leur genre. Selon un rapport de l’ONU, 73% des femmes ont déjà été la cible de la haine misogyne en ligne toutes mauvaises raisons confondues.
Le rapport du HCE reprend l’exemple médiatique du procès opposant Johnny Depp à Amber Heard "qui a fait l’objet d’une attention hors du commun sur les réseaux sociaux pendant plusieurs semaines", analyse le rapport. Pour l’auteure Rose Lamy, citée dans le rapport, cette affaire est symptomatique d’une "crise de la masculinité dormante".
Cyberharcèlement et backlash
Et le HCE d'alerter: "les menaces sérieuses de recul des droits des femmes et la crainte d’un backlash antiféministe nécessitent une intervention plus importante des pouvoirs publics à la hauteur des enjeux".
Un constat partagé par Elvire Duvelle-Charles, elle-même victime de cyberharcèlement. Sans pour autant parler d'une augmentation des cas de harcèlement en ligne, elle souligne que les actions de cyberharcèlement sont de plus en plus ciblées, que leurs auteurs sont très bien organisés en amont et que le phénomène de masse s'accentue: les mêmes personnes se sont concertées pour viser la même cible au même moment.
L'auteure pointe notamment la réponse pénale insuffisante. "Les auteurs voient qu’ils ne seront pas condamnés alors ils poursuivent leur cyberharcèlement". Elvire Duvelle-Charles souhaite que "la justice condamne davantage, que les réseaux sociaux facilitent les missions des enquêteurs et fassent un vrai travail de modération".

Lorsqu’elle a lu le rapport, le constat ne l’a malheureusement "pas étonnée". Elle remarque qu’après MeToo, "alors que les droits des femmes sont sur le point de gagner du terrain et que les politiques s’emparent de la question, les réactions violentes se multiplient". Elle prend pour exemple, le recul des débats sur le droit à l’avortement en Europe, signe "d’un backlash bien ancré", poursuit-elle.
Le cyberharcèlement donne suite à des violences dans la vie réelle. Selon une étude de l’association Féminisme contre le cyberharcèlement, 72% des victimes déclarent que les cyberviolences se sont poursuivies en présentiel.
