Pourquoi le bouclier tarifaire coûte moins qu'il n'y parait
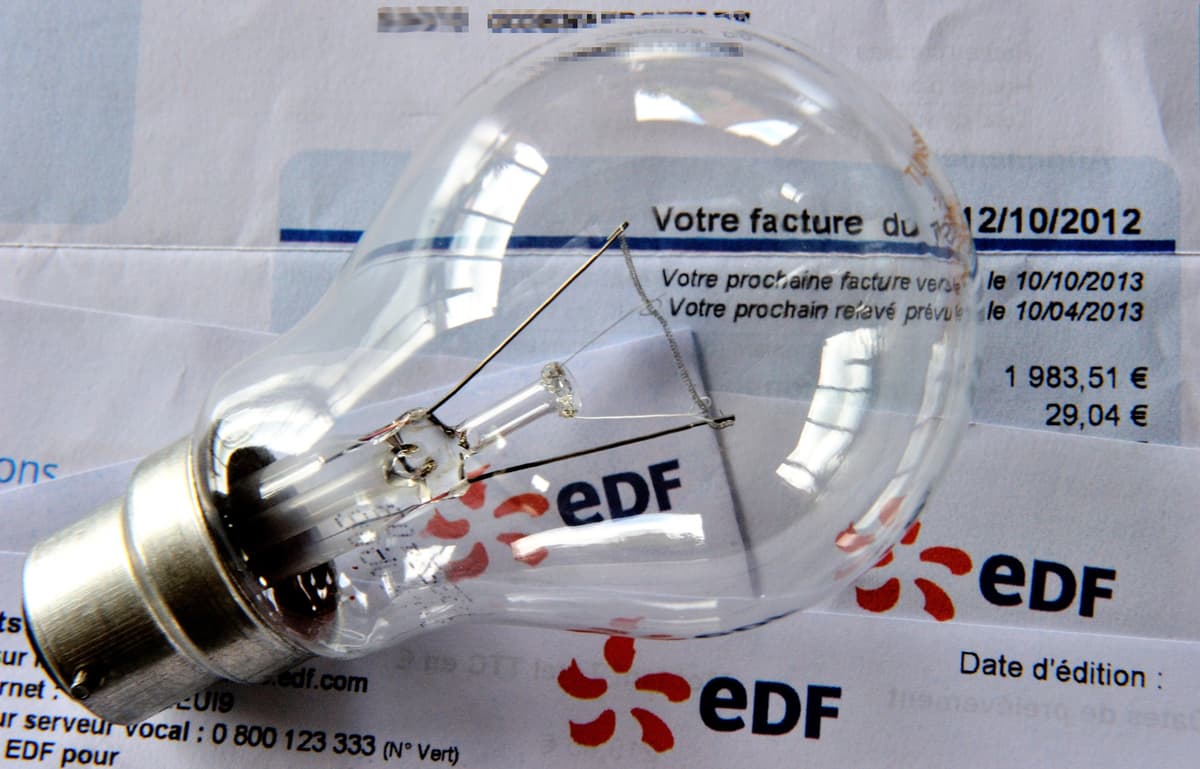
Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, l’a clairement annoncé ce week-end: le bouclier tarifaire sera partiellement maintenu l’an prochain. L’Etat va donc continuer à dépenser des milliards pour limiter l’envolée des prix de l’énergie.
Pour mémoire, cette année, selon les dernières estimations de Bercy, le coût total devrait atteindre 24 milliards d’euros (10,5 milliards pour l’électricité, 6 pour le gaz et 7,5 pour la ristourne carburant).
Cet effort financier de 354 euros par habitant est indéniablement colossal, mais s’il n’avait pas été consenti, la France ne serait sans doute pas le pays de l’Union européenne affichant l’inflation la moins élevée. En rythme annuelle, elle dépasse par exemple les 20% dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie). Mais elle est aussi beaucoup plus forte chez nos voisins plus proches comme l'Allemagne, l'Espagne ou la Belgique.
En France, l'inflation entraîne des hausses automatiques de dépenses publiques
Cet effort financier de l’Etat pour réduire la facture énergétique des ménages a un autre "avantage": il réduit l’impact de l’inflation sur les budgets de l’Etat et de la Sécurité sociale. Car l’une des particularités de la France, c’est que la hausse des prix à la consommation génère des revalorisations automatiques de dépenses publiques: pensions de retraite de base, aides sociales (RSA, invalidité, allocations familiales...) et même le salaire minimum des fonctionnaires.
S’ajoute à cela ce qu’on peut appeler des revalorisations concertées: point d’indice de la fonction publique non indexé sur l’inflation mais faisant partie de la négociation avec les syndicats, pensions de retraite complémentaire et allocations chômage dont la revalorisation est décidée par les partenaires sociaux (syndicats et patronat).
4,6 milliards d'euros de dépenses publiques en plus par point d'inflation
Bercy a évalué le coût de ces revalorisations. Pour chaque point d’inflation supplémentaire, la dépense publique augmente au minimum de 4,6 milliards et au maximum (si les retraites complémentaires, les allocations chômage, les salaires des fonctionnaires sont pleinement revalorisés) de 7,9 milliards d’euros. Bercy souligne que ces deux chiffres prennent en compte la hausse de la charge de la dette indexée.
Pour être concret, on peut comparer la situation de la France à celle de la Belgique. Chez nos voisins, l’effort de l’Etat pour réduire la facture énergétique a été beaucoup plus modeste : près de 1,1 milliard d’euros soit moins de 100 euros par habitant. Mais en même temps, la particularité de la Belgique, c’est que les revenus (salaires, retraites, allocations sociales) sont indexés sur l’inflation de façon automatique. Et donc le pouvoir d’achat des ménages belges est censé être préservé par ce système.
Sauf que l’inflation en Belgique dépasse les 10%. Elle est quatre points au-dessus de la nôtre. Et quatre points de plus cela signifierait pour la France entre 18,4 et 31,6 milliards d’euros de dépenses publiques supplémentaires. Il est donc clairement plus rentable financièrement pour l’Etat d’agir en amont, à la source de l'inflation, en limitant l’impact de l’envolée des prix de l’énergie.
