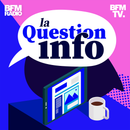Mis sous pression du public et de leurs abonnés, la majorité des influenceurs indiquent leurs partenariats, selon une étude
Des applications de réseaux sociaux sur un smartphone. - ANTON KAPPERS / ANP MAG / ANP via AFP
Il s'agit de l'infraction la plus répandue chez les influenceurs: nombre d'entre eux n'indique pas systématiquement le caractère publicitaire de certaines de leurs publications. Les collaborations commerciales (aussi appelées placements de produits) effectuées sur leurs réseaux sociaux sont l'un des principaux moyens de rémunération des influenceurs.
Que ce contenu soit payé en nature (produit ou service offert) ou non, il s'agit d'une collaboration commerciale. Et les influenceurs ont l'obligation de le mentionner de manière explicite, sans quoi ils s'exposent à une peine de deux ans de prison et de 300.000 euros d'amende. Il s'agit de ces fameuses mentions "publicité", "partenariat rémunéré" ou "collaboration commerciale".
Depuis 2021, l'ARPP, l'organisme de régulation professionnelle de la publicité en France, analyse tous les ans, dans un rapport, la manière dont les publications des influenceurs respectent la loi. L'ARPP sélectionne plusieurs dizaines de milliers de publications d'influenceurs sur Instagram, Tiktok et Youtube, et regarde si elles mentionnent bien leur intention commerciale, lorsque celle-ci existe.
Cette édition 2025 montre que certains influenceurs ne le font toujours pas. 84% des contenus analysés par l'Observatoire de l'influence responsable sont conformes, quand 16% ne le sont pas (8% sont "améliorables" et 8% ont un partenariat non identifié).
Une nouvelle méthode
Ces résultats ne sont pas réellement comparables à ceux des années précédentes, car l'ARPP a adopté une méthodologie différente pour cette étude. Le champ d'analyse a été élargi, avec l'aide d'une intelligence artificielle, pour mieux détecter les contenus publicitaires. Sont désormais pris en compte le texte, l'image et le son dans les publications, alors qu'avant, le système se limitait aux mots-clés textuels, présents dans les titres et descriptions des publications. En combinant cette technique à la précédente, l'ARPP arrive au chiffre de 84% de conformité.
Mais en ne prenant en compte que les résultats donnés par l'intelligence artificielle, les manquements sont plus nombreux. Environ 66% des contenus publiés au 1ᵉʳ semestre 2025 comportent au moins un début d’identification. Ce qui signifie qu'un tiers d'entre eux ne respecte pas la loi (11% sont "améliorables" et 23% sont "non conformes).
Cela s'explique notamment par le fait que l'IA n'analyse pas seulement des publications a priori sponsorisées. "On a largement étendu et on a décidé de scroller 400.000 contenus, qu'ils soient organiques ou commerciaux, parce qu'on voulait attraper aussi toutes les collaborations complètement dissimulées. On a une vision beaucoup plus fidèle de la réalité des pratiques avec cette approche", estime Mohamed Mansouri, directeur délégué de l'ARPP, auprès de Tech&Co.
Des audiences plus exigeantes
Autre constat de l'ARPP: les pratiques des plus petits créateurs (moins de 10.000 abonnés) se rapprochent de celles des plus suivis (plus d'un million d'abonnés), alors qu'elles étaient jusqu'alors moins transparentes.
"Alors qu’en 2023, l’écart était de 15 points (23% de manquements chez les petits contre 8 % chez les gros), puis encore de 10 points en 2024 (15% contre 5%), il n’est plus que d’un point en 2025: 7% de manquements pour les petits, contre 6% pour les gros"; souligne l'ARPP dans un communiqué de presse.
"Cette année, les taux de manquement tendent à s'uniformiser grâce à une meilleure connaissance des règles des petits créateurs", salue Mohamed Mansouri. Ce qu'il explique par le fait que ces plus petits influenceurs "font aussi partie des audiences" de leurs collègues.
"Il y a une forme de régulation organique de la part des audiences. Parce qu'elles ont connaissance du cadre légal, elles vont le dire quand les influenceurs ne sont pas transparents", note le directeur délégué de l'ARPP. Il n'est désormais plus rare de voir un abonné déplorer en commentaire qu'un produit offert n'ait pas été mentionné comme tel par exemple.
Une auto-régulation
Cette connaissance qui se généralise et va jusqu'aux audiences s'explique, selon Mohamed Mansouri, par la couverture médiatique autour de la loi influenceurs de 2023, par les scandales liés aux dérives de certains influenceurs, mais aussi par l'auto-régulation du secteur.
L'ARPP propose ainsi depuis 2021 un "certificat de l'influence responsable", sorte de formation des influenceurs aux règles de leur milieu. Plus de 2.200 créateurs de contenus sont certifiés. Le rapport de l'ARPP souligne qu'ils "respectent trois fois mieux les règles que les non certifiés" sur le volet de l'identification des collaborations commerciales.
Et lorsque l'organisme constate un manquement de leur part, un courrier leur est envoyé. En cas de répétition, l'ARPP peut suspendre leur certificat. Cela n'est jamais arrivé jusqu'alors mais, d'après Mohamed Mansouri, plusieurs cas sont actuellement à l'étude en vue d'une possible suspension.
De leur côté, les pouvoirs publics tentent aussi d'agir face aux dérives d'un métier relativement récent. Ces dernières années, plusieurs influenceurs ont écopé d'amendes pour "pratiques commerciales trompeuses", comme l'ex-candidat de télé-réalité Julien Tanti ou l'ancienne snapchateuse Poupette Kenza.